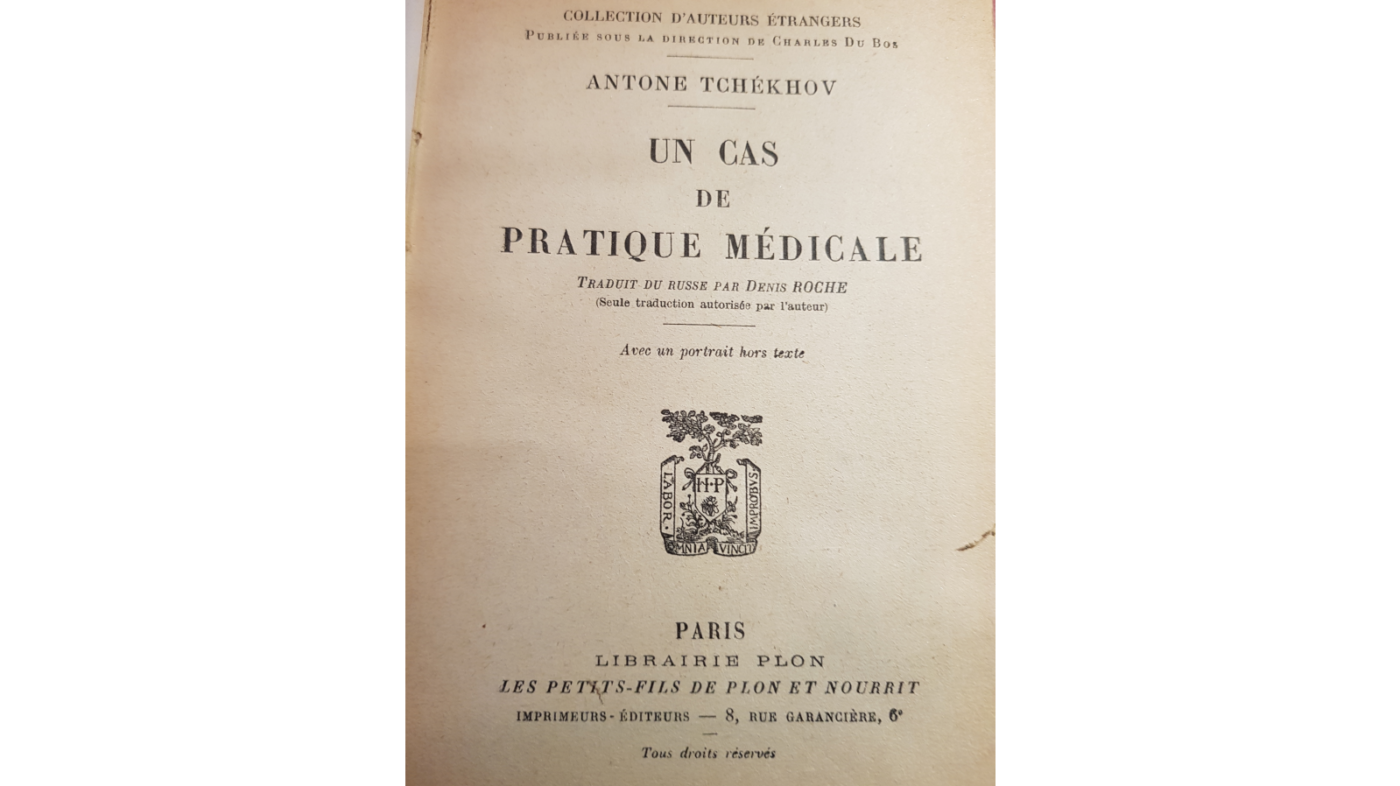LE DIAGNOSTIC, LE MILIEU ET LE SOIN
Une époque charnière
Le dernier tiers du XIXe siècle est caractérisé en Russie par un développement aussi rapide que désordonné des forces productives. Des inégalités territoriales se creusent. L’accumulation primitive met à mal les structures multiséculaires de la société tsariste féodale. Un prolétariat se constitue, concentré dans de grandes unités de production, sans traditions, propulsé du lopin de terre aux contraintes du travail industriel. Ce que l’on appellera bientôt les maladies sociales, alcoolisme, syphilis, asthme, tuberculose, font des ravages et posent des problèmes y compris au patronat. Face à ce prolétariat nombreux et pour l’instant inorganisé, le capital se dissimule, mettant en avant toute une armée de policiers, de contremaîtres et de bureaucrates.
« L’ancien se meurt, le nouveau tarde à venir, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres » : la phrase bien connue de Gramsci, écrite dans un tout autre contexte, pourrait parfaitement s’appliquer à cette société disloquée, où des élites intellectuelles bien formées et pénétrées de valeurs humanistes voient se développer non seulement la misère du jeune prolétariat, mais aussi l’inculture et la vulgarité d’une nouvelle bourgeoisie. Celle-ci, mesquine et arrogante, est faite de petits fonctionnaires souvent corrompus, de maquignons et de colporteurs en tous genre, mais aussi de personnes comme la gouvernante de la maison Lialikiov, enflées d’un faux savoir et vivant en parasites aux dépens des familles riches. Les relations archaïques du maître et du serviteur avaient au moins l’avantage de la transparence. Désormais, les relations sociales doivent être déchiffrées. Un regard diagnostic s’impose.
Une sensibilité médicale
On a souvent remarqué, pour l’admirer et parfois s’en étonner, l’extrême variété des thèmes et des manières d’écrire dans l’œuvre de Tchékhov. De la satire féroce à l’évocation pudique de silhouettes fugitives, de la parodie à la tragédie, de la notation impressionniste au réalisme le plus brutal, rien de ce que Balzac appelait la comédie humaine ne semble y avoir été oublié. Mais alors que chez Balzac règne une certaine unité de ton, celle d’un chroniqueur témoin lucide de son temps, qui est celui où les valeurs bourgeoises triomphent définitivement des codes d’honneur et des idéaux chevaleresques, Tchékhov, quant à lui, se montre plus sensible à la complexité des individus et ne cache pas ses indignations, ses étonnements et ses incertitudes. Là où Balzac est épique, Tchékhov est ironique. Là où Balzac conclut, Tchékhov s’interroge.
La diversité réelle des écrivains médecins
Il est difficile de ne pas mettre en relation cette attitude compatissante, cette ouverture au foisonnement du réel humain, avec le fait que Tchékhov était médecin. D’autres écrivains (Aragon, Breton, Joyce, Léon Daudet…) ont reçu une formation médicale, plus ou moins poussée. Mais Tchékhov est de ceux qui, à l’instar de Céline, de Gottfried Benn, de William Carlos Williams, ont été médecins de profession tout en étant écrivains de vocation. Tous n’ont pas eu la même relation à la pratique médicale. Quelques uns en ont tiré une vision très sombre du monde et de la vie. D’autres (Cronin par exemple) ont développé une réflexion plus politique sur les rapports entre le médecin, la société et les institutions sanitaires.
Tchékhov ou l’écriture du diagnostic
Chez Tchékhov, la diversité des styles, des tons, des situations décrites ou entrevues, est à l’image de la vie elle-même, telle qu’elle se donne dans l’approche clinique qui est celle du praticien de terrain. François Dagognet évoque au début de son livre Philosophie biologique ce qui fait du médecin une figure à part dans la phénoménologie des activités humaines : « le scepticisme inexpugnable du médecin, son matérialisme discret, son mépris naturel pour l’idée qui l’amène le plus souvent jusqu’à refuser de penser l’étrange matière médicale, son antidogmatisme toujours proclamé et glorifié… » Cette attention au diagnostic, sensibilité à la diversité irréductible des cas singularise la pratique médicale et pour Tchékhov, comme ce sera le cas plus tard chez Boulgakov, appelle l’écriture.
La nouvelle « Un cas de pratique médicale », écrite en 1898, s’inscrit tout d’abord dans la longue tradition des récits d’apprentissage ; un jeune interne en médecine est envoyé par son patron pour une consultation dans un lieu reculé, consultation demandée par une riche famille d’industriels mais dont la nécessité n’apparaît pas clairement. Bref, une probable perte de temps. Toute la nouvelle va être pour montrer que pour le jeune Koroliov, ce temps dépensé et cet espace parcouru définissent comme dans toute dramaturgie le lieu d’une action, passage du conditionnement subi à une compréhension où la sympathie guide l’intellect, et de là à la décision résolue.
La mauvaise consultation
Koroliov, voyageur contre son gré, découvre un paysage laid, typique de la révolution industrielle. C’est nouveau pour ce Moscovite qui « ne s’est jamais intéressé aux usines » et n’a de l’industrie qu’une connaissance livresque, « même s’il lui était arrivé de se trouver chez des industriels et de causer avec eux. » Ce qu’il voit, c’est la malpropreté, le linge qui pend aux fenêtres, des démarches vacillantes d’ivrognes, de l’obséquiosité. Il voit encore des bâtiments démesurés baignant dans une sorte de buée grise, et une poussière qui recouvre jusqu’aux lilas devant la maison où il est attendu.
Ces choses, il les voit sans trop y prêter attention. Ce sont alors des détails ennuyeux. Comme sont ennuyeuses la malade laide, sa mère éplorée « sans instruction », et plus encore la gouvernante « seule personne instruite de la maison » qui croit de ce fait « devoir parler sans interruption avec le docteur et parler absolument de médecine. » On est là au niveau de ce que Spinoza appelait « connaissance par les effets », connaissance non pas fausse mais « inadéquate », simple compilation d’informations sans lien entre elles.
Koroliov réagit d’abord en jeune homme : il trouve laide la jeune malade, déplaisant le spectacle de sa passivité. Puis son regard se fait médical et se colore d’empathie : il voit en elle « une douce expression de souffrance, très touchante et spirituelle ». Malgré tout, il demeure captif des schémas des façons de penser propres à l’esprit carabin, « Le cœur est bon… les nerfs clochent un peu, c’est normal… il faut la marier ! » Ainsi s’achève ce « premier acte » qui est celui de la consultation habituelle, de la « mauvaise consultation ». Mais si Koroliov accepte de passer la soirée et la nuit dans cette maison, si contre toute raison constituée « il se dégante », c’est bien parce que cette forme de rationalité est obscurément prise en défaut. Cependant, son sentiment est d’abord celui d’un échec. On est loin encore, pour revenir à Spinoza, d’une connaissance « par les causes ».
Du décor au milieu
Koroliov a de plus en plus conscience de se trouver devant un puzzle. Avec un art consommé de la dramaturgie, Tchékhov fait disparaître pour un temps de son récit la malade et son enveloppe maternelle. En leur absence, la pathologie non seulement ne disparaît pas, mais tout au contraire se précise et se révèle dans sa vraie dimension. Pathologie d’une famille où l’empreinte du patriarche perdure après sa mort, pathologie des rapports sociaux paternalistes idéalisés, pathologie d’un environnement mesquin et sans goût, où les gestes sont vulgaires et où les choses ne valent que par leur prix.
La réflexion de Koroliov s’élargit, dans les limites mais avec toute la portée d’une réflexion de médecin : « … ayant eu à se faire une idée exacte des affections chroniques, dont la cause initiale est incompréhensible et incurable, il considérait de même les usines comme une équivoque dont la cause elle aussi est obscure et inéluctable. » Voilà le début de la connaissance par les causes, même si celle-ci reste hésitante et maladroite. L’industrialisation, à défaut d’être pensée dans sa relation dialectique avec la mise en mouvement du capital, est perçue comme une « équivoque » : production de « mauvaise indienne » d’un côté, misère ouvrière et rapports sociaux dégradés et dégradants de l’autre. Ivrognerie, violence, vulgarité, et en contrepartie quelques adoucissements comparables « au traitement des maladies incurables ».
« Un milieu malsain », constate Koroliov. La satire sociale passe au second plan. Toutes ces pathologies sont le produit du milieu, qui est lui-même le produit d’une équivoque. Un milieu marqué par des bruits stridents intolérables, alors même que le chant du rossignol s’entend en contrepoint. Et il semblait que dans le calme de la nuit, ces sons fussent poussés par un monstre aux yeux pourpres : le diable lui-même, qui était ici le maître et des patrons et des ouvriers, et qui trompait les uns et les autres. L’aliénation est bien celle d’une société toute entière.
Dans ce monde décidément étranger à l’humain, le progrès prend la forme physique d’une régression, surtout la nuit : « On oubliait qu’il y eût là-dedans des moteurs à vapeur, de l’électricité, des téléphones ; on songeait plutôt aux habitations lacustres et à l’âge de la pierre, on sentait la présence d’une force grossière, inconsciente… »
La consultation
Quand Koroliov revient au chevet de sa malade, il a fait l’expérience personnelle de ce milieu agressif, où il se rend compte qu’il lui serait impossible de vivre. Il a aussi, plus profondément, éprouvé quelque chose comme la présence d’une maladie incurable, résistante à toute tentative de médication. Sa nouvelle rencontre avec la patiente est placée sous le sceau du partage. Il ne retient pas un geste de tendresse, celui de lui arranger ses cheveux. Ce sont d’abord deux jeunes gens qui se font face, et qui se parlent. Et Lisa lui dit l’essentiel : « Il m’a semblé qu’avec vous on pouvait parler de tout. » La vraie consultation commence sans filtre et sans hiérarchie.
Où, dans cette consultation, réside l’essentiel ? Dans la confirmation, attendue par Lisa depuis longtemps, d’une vérité que de son côté le jeune interne vient de découvrir, à savoir que, comme ne cessera de la répéter Tchékhov, « vous vivez mal ». Et que les symptômes manifestés par Lisa, qui effraient tant son entourage, insomnie, palpitations, tristesse, ne sont pas des signes pathologiques mais tout au contraire des réactions de santé. Ne pas pouvoir s’adapter à un milieu pathogène, montrera quelques décennies plus tard Georges Canguilhem, c’est poser, même dans la confusion, une valeur. C’est déjà résister. Il fait peu de doute que cette nouvelle soit l’écho, peut-être très peu modifié, d’une expérience réellement vécue. Une formation médicale se parachève toujours en fonction de situations réelles qui révèlent au jeune praticien non seulement la singularité clinique des cas et des biographies, mais aussi la réalité des milieux dans lesquels les humains se forment et se déforment. Tchékhov, fils de son temps, l’a vu et exprimé à sa manière, médicale, morale et lyrique. Une manière qui n’est pas sans efficacité.