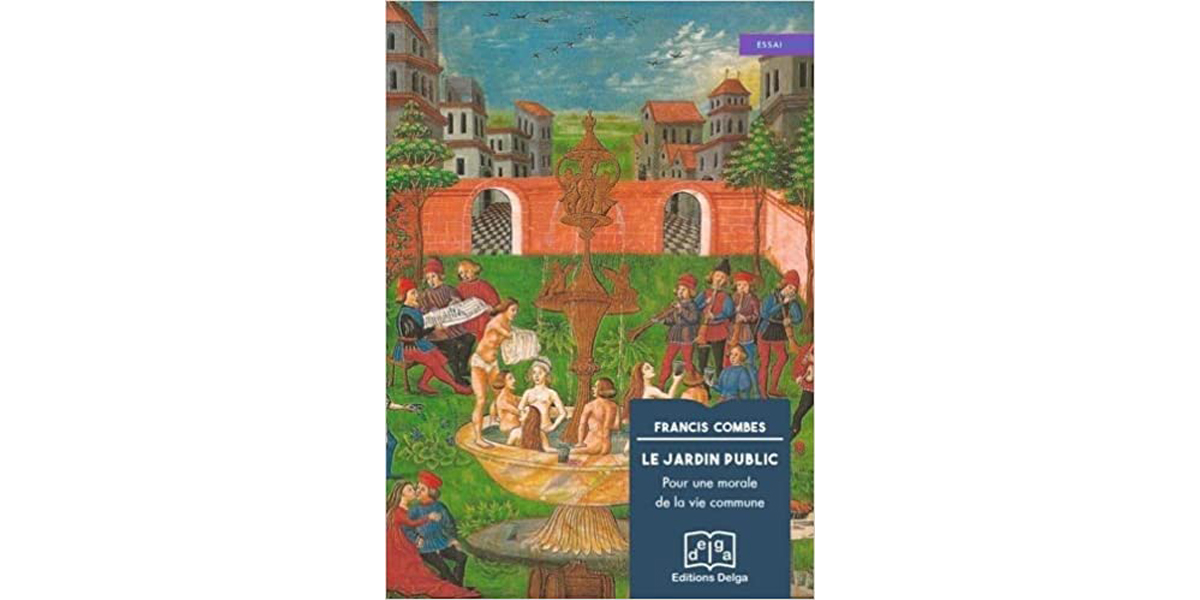Morale et politique : quand Francis Combes se révèle philosophe
Francis Combes est connu comme éditeur, poète d’une grande finesse et homme engagé depuis sa jeunesse dans l’option communiste. Or il se révèle, dans un nouveau livre intitulé Le jardin public, un étonnant philosophe lucide, pertinent et plongé au cœur de nos préoccupations contemporaines, sans la moindre réserve. L’ouvrage en réalité est double, faisant se succéder des pages philosophiques et des pages poétiques. Je m’intéresserai ici aux premières tant j’y retrouve un thème essentiel de mes propres préoccupations depuis des années, à savoir la question du rapport entre la morale et la politique – question qu’une large partie du marxisme officiel tend à négliger, sinon à refuser, alors qu’elle est fondamentale et c’est à elle que je m’en tiendrai pour l’essentiel car elle ici dominante. Et pour rassurer le lecteur habitué au poète dont la lecture est aisée, je signale tout de suite qu’il en est de même ici : il procède par paragraphes successifs, son écriture est légère, simple et limpide, sans rien céder sur le contenu. Disons que c’est une espèce d’Alain qui se montre ici, mais un Alain qui serait devenu un partisan (critique ou ouvert) de Marx dans des « propos » nouveaux.
La morale et la politique donc, même si leur traitement le fait aborder des sujets nombreux qui pourraient paraître en être éloignés mais dont je montrerai qu’ils s’y rattachent, même si je devrais en écarter certains vu leur nombre. Pour comprendre son audace théorique, il faut souligner d’emblée qu’il se situe donc dans la filiation de Marx ou d’autres penseurs de même orientation comme Lénine ou Gramsci. C’est dire qu’il faut commencer par signaler fortement que Combes est matérialiste, mais au sens d’un matérialisme qui n’est pas seulement naturaliste mais historique, comme l’auteur de L’idéologie allemande : pour lui l’homme est bien un produit de la nature matérielle, mais qui a la spécificité de la transformer par la production de ses moyens d’existence – contrairement à l’animal – et du coup de se transformer lui-même au cœur de l’histoire qu’il crée : déterminé par la nature et l’histoire économique (le libre arbitre métaphysique est un mythe d’origine religieuse), il est aussi déterminant de ce qu’il fait et est et c’est là que réside sa liberté, en expansion possible comme l’histoire elle-même, avec ses sciences et ses techniques (voir p. 8, mais les notations fourmillent sur ce sujet). A quoi il faut ajouter que cet homme n’est pas un Homme abstrait (avec une majuscule) comme le concevait Feuerbach, récusé par Marx à ce niveau, et que cet « homme » ne se réduit pas non plus à un agent économique : Combes insiste souvent sur la dimension culturelle multiple qui a façonné l’humanité avec ses croyances, ses mythes, ses religions, etc. et qu’un communisme à venir devra non les éliminer brutalement, mais en tenir compte pour les modifier éventuellement : voir ce qu’il dit sur « la nécessité des illusions » ou encore sur « la nature inachevée » de l’homme générique : on est loin de la « table rase » qui a pu caractériser le stalinisme, mais par contre on se rapproche de la nécessité d’éduquer le hommes dans le sens du bien et donc de l’importance qu’il convient de donner à l’éducation.
On touche alors immédiatement à la morale puisque toute éducation est portée par un souci moral des valeurs ou, si l’on préfère, par un souci des valeurs morales – souci que l’époque néo-libérale contemporaine jette lamentablement aux orties ! Or ici l’auteur est très clair : contre un positivisme matérialiste, mais aussi scientifico-technique ou utilitariste qui ne s’intéresse qu’à l’intérêt individuel égoïste, il prend le parti de réhabiliter, fût-ce d’une manière critique et moderne, l’instance de la morale. Son contenu universaliste rejoint celui que Kant lui a conféré, mais il ne le fonde pas sur une philosophie idéaliste et même transcendantale qui était celle de Kant. Il reconnaît d’ailleurs que cette morale, la seule possible désormais, succède à ce qu’il appelle justement des éthiques (qui se faisaient passer pour des morales (comme celles d’Épicure, des Stoïciens ou celle, religieuse qui dominait au Moyen-âge au service du pouvoir en place, etc.) et dont Engels a bien signalé l’existence et le rôle dans l’Anti-Dühring ; et comme il distingue justement l’origine et le fondement des normes, il indique bien, fût-ce à mots couverts, que les normes morales universelles ont un fondement rationnel, par-delà l’époque où elles sont historiquement apparues et qu’on n’est pas là en présence d’une idéologie de plus destinée à disparaître. C’est dire, comme il le fait, qu’accepter l’idéalité de la morale à son niveau, ce n’est pas verser dans un idéalisme impuissant, voire « angélique » (p. 20).
Par contre, il reste à savoir dans quoi et comment l’incarner. Or c’est ici que la réflexion de Combes emporte le plus mon adhésion. La morale n‘est pas seulement faite d’intentions louables et de comportements individuels (même si c’est le cas aussi) : elle « se pense en fonction de l’action » et donc : « Plus de morale sans politique ». (p. 22), Brecht à l’appui. C’est ici que l’ouvrage devient passionnant, même et surtout s’il va contre la mode, car le communisme, sans cesser de s’enraciner dans des conditions matérielles qui le rendent effectivement possible, devient « une question morale » et non un réalisme cynique de l’intérêt de tous, sans dimension normative (voir aussi p. 58) – question morale qu’un certain libéralisme, au surplus, a pu défendre autrefois ! Encore faut-il montrer comment la morale peut être socialement efficace car, comme il est très bien dit, quand on dénonce « l’impuissance morale » ce n’est pas la morale qui est en cause mais son « impuissance » quand on ne sait pas la trouver dans l’action historique. Or c’est bien dans l’analyse des conditions socio-historiques mais aussi économiques que se trouve la solution, dès lors que cette analyse entend être scientifique à la lumière du matérialisme historique marxien, dont on n’a pas trouvé l’équivalent (c’est moi qui insiste – Y. Q.). Des idéaux comme ceux de la liberté collective ou de la fin de l’aliénation individuelle (dont il multiplie justement les figures) sont alors mis en avant, mais qui rencontrent alors l’objection que fournit très normalement le spectacle de l’expérience soviétique qui, après un début louable avec l’idéal qui animait Lénine (Combes s’y réfère), s’est transformée en catastrophe indissociablement politique et morale avec le stalinisme. Comment oser encore se réclamer moralement de cet idéal aujourd’hui ?
La réponse se trouve précisément dans ce fameux matérialisme historique qui a été mal compris ou en tous cas pas appliqué s’agissant des conditions indispensables pour faire une révolution visant le communisme. Il faut donc rappeler, avec Combes, les conditions que Marx assignait à ce processus : un fort développement des conditions de l’économie industrielle et d’un peuple largement majoritaire de travailleurs qu’il impliquait, donc un capitalisme développé dont l’auteur du Capital nous a présenté le dépassement à venir possible dans une fameuse Préface de 1859 à la Critique de l’économie politique. Or l’expérience soviétique a nié ces conditions, comptant sur l’aide d’une révolution en Occident qui n’est pas venue. D’où le désastre qu’on a connu ensuite, y compris en Chine avec la Révolution culturelle de Mao-Tsé-Tong, même si la situation a évolué positivement depuis. C’est dire que cet échec, plus : cette catastrophe politique n’est pas due à la morale incarnée dans le communisme mais aux conditions de sa réalisation volontariste et ne condamne pas en lui-même cet idéal indissolublement politique et moral. C’est la grande idée, aussi, qui traverse tout ce livre et qui rejoint des choses que j’ai pu écrire, en particulier dans mon Retour à Marx.
C’est sur cette double base (la politique morale, les conditions matérielles du passage au communisme) que Combes développe sa réflexion avec des formules originales qui portent son style et qu’il peut alors multiplier les notations en quelque sorte latérales sur la morale en politique : la critique du cynisme, y compris dans un camp d’où on le croyait absent s’agissant de l’action, le refus du scepticisme dont on peut trouver un noyau dans la pensée chinoise, celui de la prostitution, l’éloge de l’amour et de sa productivité humaine et qui n’étonne pas quand on connaît ses poèmes sur ce sujet, l’éloge aussi de l’érotisme mais pris dans un sens noble comme parachèvement de l’amour lui-même et qui débouche sur le souhait d’une « société érotique » qui aurait plu à Aragon, l’apologie de la tolérance, même quand nos convictions sont fortes ou ardentes, le souci de l’épanouissement de l’individu contre un collectivisme aliénant, etc. Et j’ai envie de mentionner aussi ce qu’il dit du « nouveau féminisme » dont il déplore les excès anti-masculins ou les lacunes, à juste titre, alors que certains politiques veulent l’accaparer sans le moindre esprit critique et par électoralisme.
Reste enfin un dernier point, qui a rapport à la politique et qui a lui aussi mon accord, surtout aujourd’hui. Je ne peux que résumer une option qui est aussi la mienne : partisan de la nature à qui nous devons beaucoup de choses et dont nous sommes de toute façon dépendants, l’aimant à titre personnel et en tant que poète, il s’en prend à une écologie réactionnaire et dominante centrée sur les seuls excès de la consommation individuelle et, surtout, qui ne s’en prend pas au capitalisme en tant que tel, alors que c’est lui le prédateur principal de la Nature et, à terme, de l’homme lui-même. C’est un peu ce que le titre du livre veut dire en évoquant un « jardin public », c’est-à-dire un monde naturel que seul le communisme est à même de nous faire habiter paisiblement à la fois individuellement et tous ensemble.
Je m’arrête-là, en espérant avoir donné envie de lire ce livre original et d’en compléter la lecture par celle de ses poèmes.