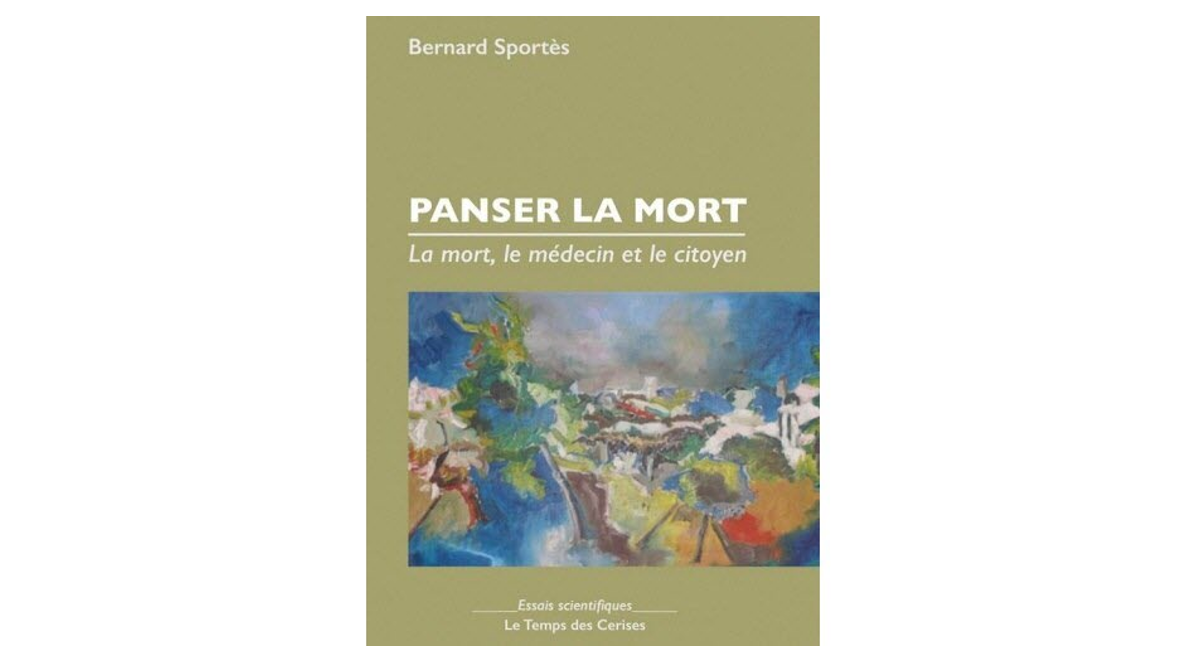Résumé :
L’auteur qui a écrit un livre sur la fin de vie que nous avons déjà présenté revient sur ce thème : il propose une continuité dans la prise en charge des mourants dans les services qui les ont accompagnés dans leurs maladies et demande une modification des structures sanitaires dans cet esprit.
Abstract :
The author who wrote a book on the end of life that we have already presented returns to this theme: he proposes continuity in the care of the dying in the services which supported them in their illnesses and calls for a modification of the structures sanitary facilities in this spirit.
Les unanimités sont rares en démocratie, assez rares pour qu’on les remarque et surtout assez rares pour qu’on s’en méfie. L’unanimité absolue qui règne autour des Soins Palliatifs dans ce débat sur la fin de vie est certainement de celles qui doivent appeler notre attention. De toutes parts et comme d’une seule voix, il nous est dit que les soins palliatifs sont sous-dotés, qu’il faut les développer, les enseigner mieux et plus et les mettre plus facilement à la disposition de celles et ceux qui en ont besoin. Sauf à apparaitre cruel comment ne pas joindre sa voix au chœur ?
Les soins palliatifs : une place à part.
Les soins palliatifs, sous leurs airs de simple spécialité médicale, sont en fait l’aboutissement d’une évolution politique qui débute avec les révolutions bourgeoises et s’achève dans les années soixante, quand, au sommet de son arrogance, la médecine décide que les mourants sont des objets de soins. Ce n’était pas le cas. On rapporte l’anecdote mythologique de Cicely Saunders, l’inventeuse anglaise du concept de soins palliatifs, créatrice de la plupart de ses concepts et animatrice du premier lieu de soins palliatifs, le St Christopher Hospital. Pour son mémoire de fin d’études infirmières, la future médecin, s’assoit dans un couloir d’hôpital un chronomètre à la main ; elle mesure le temps passé par les soignants dans les chambres des mourants pour s’apercevoir que ceux-ci sont littéralement abandonnés une fois le pronostic fatal posé. Elle estime qu’au contraire, ils devraient être l’objet de plus de soins et qu’objectivement « il reste beaucoup à faire quand il n’y a plus rien à faire »[1].
Jusque dans les années soixante, la mort ne faisait pas partie de la médecine et le mourant non plus. La mort en médecine était niée, interdite de séjour ; le patient était tenu à l’écart des mauvais pronostics, les familles aussi dans une moindre mesure et rien n’était prévu médicalement pour accompagner le mourant. Il était alors inconcevable de dire la vérité non seulement aux patients mais aussi à ses proches. Le patient mourant était un exclu de la médecine, voire un ennemi, quelqu’un qui n’avait pas voulu guérir, ou pu guérir, un échec. Mourir n’était pas une maladie, le mourant n’était pas un objet pour la médecine. Il appartenait à un autre monde.
En 1967 tout bascule. Bien sûr pas en un seul jour mais plutôt rapidement au regard de l’importance du bouleversement et de l’inertie habituelle des mentalités. On n’a pas fini d’analyser la prodigieuse richesse ni la profondeur des remises en question initiées par ces années-là. Le patient est révolutionnairement placé au centre du projet de la médecine, une place qu’il n’avait jamais occupée. On l’écoute, on l’entend. Les révolutions créent des inversions. La place du patient est retournée : d’objet, il devient sujet, de passif il devient actif, muet il parle, de récepteur il devient émetteur. La révolution est loin d’être achevée mais conceptuellement la mutation a été fulgurante. Au milieu de ce chambardement, le mourant d’exclu devient inclus et se retrouve objet de la sollicitude médicale. Les soins palliatifs sont nés.
Le couple parental des soins palliatifs est des plus surprenants. D’un côté un mouvement religieux pour qui le mourant était déjà une clientèle mais qui le réintègre dans la toute séculière médecine. De l’autre, la horde rebelle de chevelus et de barbus qui investit le temple de l’hôpital, conspue les mandarins[2], déboutonne la blouse, pose une fesse sur le lit du patient et l’écoute avant de parler : un comble ! Et tous deux, le curé et le babacool, de brandir comme un manifeste la potion du St Christopher Hospital, à Londres d’où se répand une formule de morphine, cocaïne, visant à calmer les douleurs rebelles ; elle terrifie les pontes et l’Ordre des médecins qui mettra trente ans à l’accepter et excommuniera à tour de bras en attendant.
Replacer le patient au centre du soin, l’envisager dans sa globalité humaine, dans ses dimensions physique, psychique, émotionnelle, historique, professionnelle, familiale, sociale et spirituelle, faire que son projet de vie soit la norme du soin, définir avec lui son projet de santé, reconnaitre toutes ses souffrances, tous ses inconforts comme dignes de soin et s’acharner à les calmer, lui reconnaitre un droit de décider, de refuser, de savoir, de comprendre, donner du sens aux soins, ne pas nier la mort et l’accompagner, tous ces concepts qui alimentent maintenant les grilles de certification de nos lieux de soins ont été inventés, promus, réfléchis, théorisés et expérimentés dans ces laboratoires à idées qu’ont été les soins palliatifs depuis quarante ans.
Ce qui au milieu des années soixante était considéré comme une dangereuse utopie, irréaliste et subversive par le monde médical officiel, s’est retrouvé être la norme et la loi 30 ans plus tard dans la loi Kouchner de 2002 ! C’est assez exceptionnel pour être mentionné et les jeunes générations gagneront à savoir que leurs plus folles utopies sont le plus court chemin vers le futur ! Les soins palliatifs n’ont pas seulement réintégré le mourant parmi les vivants habilités à recevoir des soins, ils n’ont pas seulement démystifié la morphine, ils ont inversé le paradigme de base de la médecine. Et puisqu’on voit mal au nom de quoi on refuserait à ceux qui vont guérir la qualité de soins qu’on dispense désormais à ceux qui vont mourir, les concepts des soins palliatifs ont imprégné toute la médecine.
Toute ? Non. Loin de là.
Parce que le schéma d’organisation des soins, la structure hospitalière elle-même, l’organisation de la santé, son modèle économique, sa structure hiérarchique, l’orientation de la recherche médicale, le mode et le contenu des enseignements médicaux[3] tournent le dos à ces concepts. Notre médecine fait un grand écart permanent. Ses concepts théoriques, principes reconnus, brandis, sont ceux du nouveau monde tandis que son organisation industrielle, économique, sociale reste celle d’un autre monde opposé à ses principes. Un autre nouveau monde : celui du néo-libéralisme.
- La médecine prétend s’articuler autour des attentes du patient ? Elle s’organise autour du médecin dans une véritable politique de l’offre !
- La médecine affirme qu’elle considère le patient dans sa globalité ? Elle s’organise autour de l’organe, du symptôme, du spécialiste, du super spécialiste.
- La médecine affirme qu’elle recherche le sens et le bien-être ? Elle s’organise autour de l’acte médical conçu comme un produit dans une logique consumériste.
- La médecine place le projet du patient au centre de son action ? Elle s’organise en une standardisation industrielle où le patient choisit son projet dans un catalogue.
- La médecine réfute l’obstination déraisonnable ? Elle ne valorise que l’acte pur, l’action.
- La médecine se veut proche du patient, de son lieu de vie, de ses besoins ? Elle se construit autour d’un hospitalo-centrisme délirant ; elle ne valorise que la technologie de pointe, industrielle si possible.
- La médecine affirme coordonner ses soins, leur donner un sens tout au long de la vie du patient, valoriser les transversalités, être une médecine de terrain ? Elle valorise et rémunère ses médecins d’autant mieux qu’ils sont spécialisés, super spécialisés, loin du patient, près de l’organe ou de la technique. Elle néglige et déconsidère ceux qui respectent ses principes.
- La médecine se veut diverse, multiforme, proche, fraternelle ? Elle n’accepte dans ses rangs que des mutants surdoués et les forme comme des clones.
Notre organisation médicale, industrielle et néo-libérale, tourne le dos aux principes qu’elle promeut. On va continuer de s’obstiner déraisonnablement parce que nous sommes organisés pour cela, uniquement pour cela et rien ne nous interdit de le faire et tout nous encourage à le faire. On continuera de ne pas écouter le patient parce qu’il n’y a de place pour la parole du patient que dans les principes mais aucune dans notre organisation. On continuera de découper le patient en organes, en symptômes de plus en plus microscopiques. On continuera d’offrir une médecine insensée, sans sens, parce que nous ne proposons plus que des actes, lesquels ne sont que des produits industriels et que nous n’évaluons notre action qu’en comptabilisant combien nous en avons vendu et non pas s’ils ont été utiles au patient.
Et il est fort possible que dans cette folie de la médecine-produit, nous rajoutions au catalogue des protocoles d’aides à mourir. Leurs promoteurs veulent que l’on complète l’offre ! Et la demande existe. Économie de la mort donc.
Compte tenu de l’organisation de notre médecine, nous avons sans doute réalisé presque le maximum possible dans l’accompagnement des mourants. Certes, cette organisation est parfois pertinente et efficace dans nombre de situations. Mais pas pour toutes, loin de là. Pas pour la mort qui vient en tout cas. En ce qui concerne l’accompagnement des mourants, si une partie au moins de notre système de soins ne s’organise pas radicalement différemment, nous ne progresserons plus qu’à la marge. Car avec l’organisation actuelle de la médecine, même les soins palliatifs sont aspirés par la logique industrielle et consumériste ; les mourants deviennent des consommateurs de produits spécifiques labélisés fin de vie, dispensés par des super clones intelligents gavés de protocoles validés, la nourriture exclusive de tout bébé soignant, garantie pensée à l’avance, sans la moindre impureté et bien évidemment politiquement correcte. Les soins palliatifs sont devenus une des spécialités du monde médical industriel. C’est très bien et c’est très triste.
Pour comprendre ce paradoxe il faut se demander ce qu’est une spécialité au juste.
Qu’est-ce qu’une spécialité ?
Qui soigne les diabétiques en France, les insuffisants cardiaques, les asthmatiques, les psoriasis, les parkinsoniens ? Tout le monde.
Les généralistes en tout premier lieu qui effectuent l’immense majorité de ces prises en charge. La plupart des diabétiques n’ont jamais vu de diabétologue ou alors une fois au début de leur maladie ou ici ou là tous les 3 ou 4 ans. Quelques rares fois, le suivi est concomitant avec une équipe spécialisée et de façon exceptionnelle pour certaines maladies très rares, ce sera le spécialiste qui va mener la danse mais jamais seul… le généraliste restera présent.
Mais à la question : qui soigne les diabétiques et autres maladies, nous n’avons pas répondu : les généralistes, nous avons répondu : tout le monde. Parce que quand vous êtes diabétique et que vous vous faites opérer d’une fracture de jambe, les médecins et les infirmières du service de chirurgie s’occupent de votre diabète aussi et de toutes vos autres maladies… même s’il faut parfois leur tordre le bras pour qu’ils le fassent. Les spécialistes sont là pour les cas compliqués, graves, pour les techniques de pointe, pour les diagnostics et les trajectoires thérapeutiques complexes, nouvelles ; ils ont partie liée avec la recherche, ils conseillent et orientent et attendent de leurs collègues qu’ils prennent en charge la grande majorité des pathologies dont ils ont peut-être été les pionniers mais qui désormais relèvent des soins courants.
Sauf en ce qui concerne les soins palliatifs où la majorité des médecins, généralistes y compris, se déclarent incompétents.
Les soins palliatifs sont ainsi dans cette position paradoxale ; on leur demande d’être à la fois les spécialistes de pointe et ceux qui assurent toutes les prises en charge quotidiennes des mourants. Si seuls les diabétologues soignaient les diabétiques, il faudrait sans doute multiplier leur nombre par cent ou mille. Il en va de même pour nos mourants. La plupart d’entre eux ne réclament pas des soins de spécialités de pointe.
Pourtant les soins palliatifs sont enseignés aux soignants, médecins et infirmières, dans le cursus normal de leurs études. Pour les médecins par exemple, il existe un module transversal « douleurs et soins palliatifs » dont un quart est consacré aux soins palliatifs avec une première approche plutôt de qualité. Pourquoi alors ces jeunes médecins ne prendront pas ou mal en charge les mourants ? Parce que les livres ne sont que la moitié d’un enseignement, l’autre moitié est l’exemple donné par les séniors, les médecins, hospitaliers ou pas, et qu’auprès de leurs maitres les jeunes médecins vont apprendre qu’on ne s’occupe pas des mourants, que ce n’est pas leur rôle et que ces patients doivent être dirigés ailleurs.
Rediriger les mourants : la grande passion de la médecine
La médecine industrielle se décline en « actes » : le produit de base. Toute industrialisation vise d’abord à analyser le process de fabrication, à le fragmenter en tâches de plus en plus petites, à les isoler puis à les confier à des personnels ultra spécialisés. Quand elle met en œuvre des process industriels de haute productivité, soutenue technologiquement par une science débridée, fragmentant des objets maitrisés par des techniciens hyperspécialisés, la médecine libère une puissance quasi magique. Mais quand, face à la mort par exemple, elle a affaire à une personne, sa structure industrielle devient un obstacle et elle échoue.
En cancérologie, par exemple, les médecins définissent et mettent en œuvre des stratégies actives et souvent performantes mais le jour où une décision d’abstention thérapeutique est prise devant une évolution péjorative, il n’y a plus de place dans le service pour le patient. Si le patient peut retourner à son domicile c’est sans doute ce qu’il sera incité à faire. Mais si son état lui interdit ce retour, commence alors le grand jeu des services de spécialités : trouver une place. L’urgence est de se débarrasser du patient sous peine d’être réprimandé (ou puni) par l’administration qui constatera une baisse de productivité du service. S’ils s’encombrent de leurs mourants, ces services vont « vendre » moins de chimiothérapie, moins de soins techniques. Les services de soins palliatifs ont aussi leur productivité à protéger[4], alors si le pronostic vital ne semble pas engagé à court terme, on proposera des services de convalescence par exemple (pourtant mourir n’est absolument pas un processus de convalescence !) ou d’EHPAD (Si le patient est éligible et qu’il y a des places). Puisqu’il n’y a plus aucun acte envisageable dans le catalogue du service de cancérologie (et que s’occuper d’un mourant ne figure pas dans la liste des actes disponibles) le patient n’y a plus de place.
Les patients vivent très mal ces redirections. Ils ont pu croire dans la relation à leur cancérologue, ils ont souvent adhéré, voire effectué un véritable transfert sur ce médecin ou cette équipe. Mais quand ils s’aperçoivent qu’on ne les soignait pas eux en tant que personnes, mais seulement la partie éligible de leur cancer à leur catalogue d’actes, ils vivent comme un abandon et une trahison ce qui effectivement est un abandon. Quand il se révèle, ce quiproquo est brutal et il vient s’ajouter bien sûr à la mauvaise nouvelle que les visées thérapeutiques sont éteintes. Et encore ! Ce moment est bien souvent celui des mensonges. On va repousser les traitements, les suspendre un certain temps, envisager cette convalescence, ou tenter ces traitements les moins toxiques possible affublés de l’horrible nom de chimiothérapie compassionnelle qui maintiennent le patient dans l’illusion d’un traitement. Mais en fait, il s’agit d’éviter la conversation qui évoque la fin, ses modalités et sa prise en charge. Manque de courage sans doute mais pas seulement. La fin ne sera pas évoquée parce que le service ne gère pas les fins ; les fins ne relèvent pas de ses compétences. Ce qui est si vrai du cas d’école de la cancérologie est vrai également de toutes les spécialités.
Les mourants ne sont pas, ou mal, pris en charge dans la médecine française parce que, à part pour les soins palliatifs, s’occuper des mourants n’est le boulot de personne. Les spécialistes se déclarent incompétents en la matière — ce n’est pas leur spécialité — et les généralistes sont le plus souvent sans expérience réelle dans le domaine et de toutes façons, les patients sont « ailleurs ». Les étudiants constatent et reproduisent. Envoyer « ailleurs » le mourant ou celui qui a épuisé le catalogue d’actes possibles est l’échec le plus patent de notre médecine. Dès qu’elle n’a plus affaire à un organe, à une tumeur, à un dysfonctionnement, dès qu’elle a affaire à une personne dans sa totalité, elle se retire et se déclare incompétente. Ces « ailleurs » — convalescence, EHPAD, hospitalisations à répétition quand une complication survient — ne sont généralement pas plus compétents que les services hyper-techniques : bref celui qui voit sa mort venir n’a, dans notre médecine, de place nulle part.
Sauf en soins palliatifs. Mais il faut le redire, les services de soins palliatifs sont des services ultraspécialisés qui accompagnent les cas difficiles, ce sont des services de recherche. Vouloir que les soins palliatifs s’occupent de tous les mourants, c’est vouloir que les diabétologues s’occupent de tous les diabétiques ; c’est irréaliste, extraordinairement couteux et très probablement impossible.
Le chef de l’État et la ministre ont donné tous les deux les mêmes chiffres concernant le plan gouvernemental d’augmentation de la dotation des soins palliatifs en France notamment pour atteindre l’objectif d’une unité par département. « Nous consacrons actuellement 1,6 milliard d’euros aux soins d’accompagnement. Avec la stratégie décennale, sur l’ensemble de la période, c’est un milliard d’euros de plus que nous allons y investir »[5]. Un simple calcul montre que 1 milliard sur 10 ans, soit 100 millions par an pour un budget actuel de 1.6 M€ représente une augmentation de 6.25 %. Quand on sait que l’inflation n’est généralement pas compensée dans les dotations ARS, l’augmentation réelle risque de tourner autour de 2 à 4 % soit un effort minime qui n’arrivera pas à résorber le retard. Mais à supposer que nous multiplions par dix l’effort financier pour les soins palliatifs, que nous atteignons le chiffre mirobolant de 10 services par département (ce qui serait très injuste pour les autres branches de la médecine), nous serions toujours très loin du compte. Tout le monde meurt et mis à part les morts subites, tout le monde aura besoin d’être accompagné dans ses derniers jours !
Alors nos penseurs n’avaient que deux choix devant ce dilemme. Faire en sorte que, comme pour tout le reste de la médecine, ce soit l’affaire de tous ou construire des « ailleurs » rien que pour nos mourants. Et bien sûr, ils ont fait le mauvais choix ! De façon très significative, dans le projet de loi sur la fin de vie, il est prévu des « maisons d’accompagnements » qui devraient « soulager » les autres « ailleurs » de leurs mourants. Bien sûr, « business is business », ce qui prévu est notoirement insuffisant pour recevoir les mourants (une maison par département), le budget alloué tout aussi insuffisant pour accompagner ces patients difficiles et histoire de bien les stigmatiser, l’hébergement dans ces maisons sera payant ou à la charge des mutuelles ! En fait « d’ailleurs » les mourants vont donc aussi être éjectés de la solidarité républicaine[6] !
Les maisons d’accompagnements du projet obéissent à une triple finalité : maintenir et renforcer la fragmentation des soins, ne pas encombrer les convalescences et les Ehpad et faire payer par les mutuelles l’hébergement dans ces structures. Elles prennent acte donc de l’éjection des patients au bout des possibilités techniques du système de soin. L’abandon est majoré de la double peine d’un circuit « réservé » et payant.
Réintégrer les mourants dans nos prises en charge.
Que faire ? Comptez sur les seuls soins palliatifs pour accompagner nos mourants est irréaliste, très onéreux et peu souhaitable, continuer de rediriger « ailleurs » les mourants est tout aussi irréaliste, tout aussi couteux et rajoute de la maltraitance à l’abandon. Alors nous n’avons sans doute pas besoin d’augmenter tant qu’on le dit les unités de soins palliatifs et certainement pas besoin de multiplier les « maisons d’accompagnements », nous avons simplement besoin que tout le monde s’y mette, médecins et institutions.
Mais dans notre médecine, les résistances sont très fortes. Même formés, les médecins spécialistes sont réticents à accompagner les mourants et leur hiérarchie les encourage à se concentrer sur les seuls actes techniques, performants, rentables et comptabilisables. Un service de pneumologie, de gastro-entérologie, d’ORL, de cardiologie, de néphrologie peut avoir un mort par semaine (50 par an !) et toujours considérer que s’occuper des mourants n’est pas dans ses attributions. Un cancérologue dont 30 à 40 % peut-être des patients vont mourir, pensera de même. Ils vont au mieux diriger le patient vers une équipe mobile de soins palliatifs (surbookée) et le plus souvent trouver une place « ailleurs » et si par malheur le patient meurt chez eux, sauf à de très rares et très louables exceptions, le travail sera mal fait… s’il est fait.
Dans les derniers chapitres de mon livre « Panser la mort »[7], j’essaye de penser une évolution de notre organisation médicale en une « médecine de la personne » qui, entre autres et sans bouleversements majeurs, permettrait aux mourants de garder leur place dans le soin. Mais sans attendre ces évolutions structurelles, on peut facilement imaginer de pallier cet abandon de nos mourants par simple voie réglementaire. Notre médecine comme toute l’administration française, jacobinisme oblige, étant fortement centralisée, il suffirait d’une forte impulsion de nos ARS[8], de l’État donc, pour réintégrer nos mourants dans les lieux de soins[9].
Analyser la file active de chaque service, en déduire le pourcentage de décès attendu et obliger ces services à y consacrer autant de ressources qu’ils ont de décès semble facile à faire. Après tout, si par exemple, un service de gastro-entérologie a dans sa file de patient 15% de cancers coliques, il s’organise bien pour y consacrer 15% de ses ressources, techniques et humaines. Il « suffit » alors, par simple voie réglementaire, d’introduire dans la certification de nos services hospitaliers, l’obligation d’intégrer l’accompagnement des mourants dans leurs projets, de leurs mourants. Si un service voit x % de ses patients mourir chaque année, il devra consacrer x % de ses lits à l’accueil des mourants, x % de son plan de formation professionnelle, x % de son organisation. On verra ainsi, intégré dans chaque service, des places, des compétences, un mode de fonctionnement orienté vers les phases terminales des patients de chaque service. La culture palliative, la vision globale des trajectoires, la réflexion collective s’instaureront au sein de toute activité médicale. Si une véritable volonté politique existe, il ne faudrait sans doute pas plus de 5 à 10 ans pour opérer cette mutation ; imposer une prise en charge systématique de toutes les douleurs a pris moins de temps que cela au début de ce siècle. Les coûts en infrastructure sont négligeables, les compétences de formation existent, les formations initiales aussi, resteraient à vaincre des réticences professionnelles. Trop de médecins hyperspécialisés ne se vivent plus que comme des techniciens et il faut les aider à retrouver le sens premier de leur métier : accompagner.
Il faudra aussi vaincre des réticences « industrielles ». Obliger un service hyper-technique, à très forte rentabilité, à faire autre chose que sa technique pour s’occuper humainement de ses patients jusqu’au bout de leur vie sera vécu par certains technocrates comme une baisse de rentabilité. Il faudra alors leur expliquer que l’industrie médicale est au service des patients et non pas les patients-clients au service de l’industrie comme beaucoup le croient.
Les patients seront soulagés d’être maintenus au sein des équipes qui les ont pris en charge dès le début de leur maladie ; ils n’auront plus à craindre l’abandon ni d’être envoyés « ailleurs ». Et, très vraisemblablement, puisque désormais ils vont s’occuper de leurs patients y compris dans la phase palliative, les médecins auront d’autres choses à leur proposer que les très onéreuses surenchères technocratiques actuelles. Réintégrer la gestion des fins de vie dans les trajectoires de prise en charge, parce qu’elle va réintégrer une pensée globale centrée sur la personne, va évidemment diminuer les impasses techniques auxquelles sont confrontés tant de praticiens. Et cela entrainera probablement une baisse des dépenses importantes, baisse qui ne sera sans doute pas vue d’un bon œil par ceux à qui bénéficient ces dépenses insensées.
Nous avons, tous, tout à gagner d’ouvrir toute notre organisation à l’accompagnement des mourants. Les patients et leurs proches, bien sûr, qui vont se savoir toujours accompagnés, d’emblée et jusqu’au bout ; les soignants qui vont retrouver le chemin du sens du soin et une approche humaine et globale de leurs patients ; les institutions qui, elles-aussi, vont y retrouver leur raison d’être ; les finances publiques qui vont bénéficier de l’arrêt des dérives technocratiques sans sens, … et les mourants bien sûr qui auront enfin une place.
Mais il faudra déloger les intérêts industriels de leur passion d’une médecine fragmentée dévouée à leurs seuls intérêts… et c’est affaire de bulletins de vote…