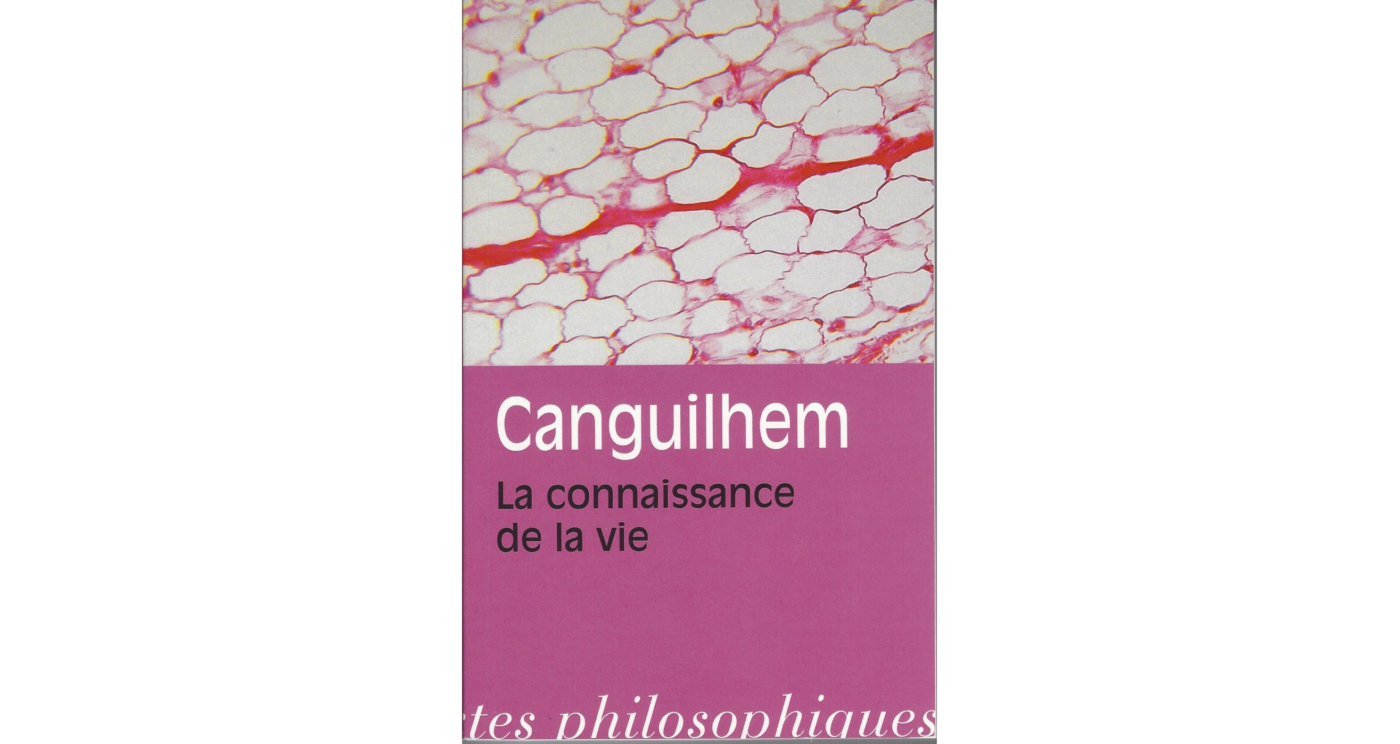Georges Canguilhem (1904-1995) a été une figure majeure de la philosophie française au XXe siècle. Hostile aux modes et à la médiatisation, fidèle aux valeurs de la Résistance, ce « philosophe du concept », professeur exigeant et travailleur infatigable, était aussi médecin et historien de la médecine. Il a formé des générations de chercheurs et d’enseignants. Il a œuvré au décloisonnement tant de la médecine que de la philosophie en articulant l’une et l’autre à l’histoire des idées, donc à l’histoire tout court, et dans cette histoire, au maintien et à la recherche de valeurs humanistes et progressistes.
« Nous attendions de la médecine une introduction à des problèmes humains concrets » : dès les premiers mots de sa thèse de doctorat de médecine, intitulée sobrement « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique » (université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand 1943), Georges Canguilhem justifie la démarche qui l’avait conduit, jeune professeur de philosophie de formation littéraire, à entamer des études de médecine. Non, il ne s’agissait pas pour lui de compléter sa formation par une initiation aux sciences : les rares philosophes qui le font préfèrent d’ordinaire, à cette fin, les mathématiques, réputées « dures », c’est-à-dire strictement objectives et à ce titre soustraites à tout débat de normes. Les sciences de la vie les attirent beaucoup moins, malgré l’exemple donné au début du XXe siècle par Bergson dans L’Evolution créatrice[1], ou peut-être justement à cause de cet exemple : Bergson n’avait-il pas superposé à un savoir réel et bien documenté toute une métaphysique d’orientation spiritualiste ? La médecine a pour les philosophes, comme pour l’opinion publique en général, un statut hybride, science et art à la fois, ni tout à fait l’une ni tout à fait l’autre, et de ce fait se trouve rarement choisie comme discipline complémentaire. A quoi s’ajoutent des considérations d’ordre pratique : les heures d’enseignement, la présence indispensable à l’hôpital, la fréquentation des amphithéâtres et des laboratoires, l’apprentissage de gestes techniques délicats tout cela se fait loin des livres et prend du temps.
Mais c’est justement cet aspect complexe de la médecine, sa situation au carrefour de diverses disciplines et plus encore l’irréductibilité de la clinique à une simple « mise en pratique » de la théorie, qui ont intéressé le jeune philosophe. L’humanisme dont il se réclamait en tant que militant pacifiste pétri du souvenir de la Première guerre mondiale, il a voulu lui donner un prolongement au niveau de l’individu plutôt que dans un engagement politique. Alors que dans le cas des sciences « dures », la seule norme est le vrai, dans les sciences de la vie et notamment en médecine d’autres normes apparaissent : l’urgent, le bénéfique, le judicieux, le prudent, le nécessaire… toutes normes renvoyant à une évaluation, donc à une dimension subjective. Et il est fréquent que ces normes se contredisent entre elles et génèrent des conflits difficiles à arbitrer. Si la partie théorique de la médecine semble normée par le seul critère de vérité, il n’en va pas de même, à l’évidence, pour la clinique et la thérapeutique. De fait, c’est la pathologie qui sera au centre des préoccupations du jeune Canguilhem. Avec une question en sous-main : qu’est-ce au fond que la santé ? Et à l’horizon, une question plus vaste et plus radicale encore : qu’est-ce que la vie, dans son rapport au vivant que nous sommes ? Questions traitées de façon beaucoup trop sommaire dans l’histoire, tant par les médecins que par les philosophes.
Un penseur du vivant très informé des techniques
Très attaché à son terroir languedocien, formé dès l’enfance par nécessité au travail des champs (les plus âgés étaient au front, et il se définira toute sa vie comme « laboureur »), Canguilhem n’avait pas pour les techniques le dédain souvent affiché à leur égard par les intellectuels. Par contre, son attention a été attirée très tôt sur la nécessité, mais aussi sur la difficulté, de tracer une ligne de démarcation stricte entre le mécanique et le vivant. N’est-ce pas la technique qui à la fois les rassemble et les différencie ? Tout organisme, même le plus rudimentaire, est un système de moyens et de fins ; mais l’organisme humain, passé un certain stade de développement, crée ses propres fins et son propre milieu. Il brise, comme Marx l’avait déjà souligné[2], le métabolisme entre l’homme et la nature. Il cesse d’être capacité passive d’adaptation pour devenir puissance active de transformation. Hostile à toute exaltation mystique ou romantique de « la vie », Canguilhem récusait tout autant le matérialisme mécaniste et réducteur très répandu dans les écoles de médecine depuis le XVIIIe siècle. Et ici, il se reconnaissait un ancêtre : Diderot, « matérialiste vitaliste »et illustrateur, dans L’Encyclopédie, de l’efficience et de l’historicité des techniques humaines, parmi lesquelles l’art médical. Dans La Connaissance du vivant[3], il cherche à dépasser l’opposition traditionnelle entre le mécanisme (issu de la tradition cartésienne) et le vitalisme (élaboré par l’École de Montpellier et fécond dans la « médecine romantique », mais aussi chez Claude Bernard). En effet, si le mécanisme donne des résultats pratiques indiscutables, le vitalisme, malgré ses aspects irrationnels et parfois inquiétants, possède une valeur heuristique et permet d’approcher la spontanéité du vivant. « La vie, c’est la création », rappelait Claude Bernard.
La vie comme norme des normes
Juste avant de se mettre en congé de l’éducation nationale « pour ne pas avoir à enseigner travail, famille, patrie » et de prendre le maquis – où il sera médecin militaire – Canguilhem passe sa thèse de doctorat. Vingt ans après, en 1963, il devait en réaffirmer l’essentiel : « La clinique et la pathologie sont le sol originaire où s’enracine la physiologie, et comme la voie par laquelle l’expérience humaine de la maladie véhicule jusqu’au cœur de la problématique du physiologiste le concept de normal »[4].
Toute la réflexion ultérieure de Canguilhem se trouve résumée dans cette phrase. Car les concepts de norme et de normalité ne vont aucunement de soi : ils doivent être construits, et plus encore mis en relation avec le vivant humain individuel, lequel n’est pas seulement l’objet d’un savoir et d’un ensemble de pratiques en tant que porteur de telle ou telle pathologie bien ou mal connue, répertoriée ou non, mais sujet de ses propres normes. Canguilhem se souvient que dès les années 1930, le sociologue Maurice Halbwachs avait alerté sur la confusion entre moyenne et normalité[5] : il n’y a pas de type idéal chez les êtres humains et il n’est pas souhaitable qu’il y en ait. Il est facile, et tentant, de calculer statistiquement les mensurations, les rythmes biologiques ou l’espérance de vie moyenne de tel ou tel groupe humain, voire de l’espèce humaine en général. Mais ce faisant, on détermine simplement des états de fait, et nullement des valeurs. La moyenne est un fait, la norme est une valeur. La moyenne est constatée, la valeur est posée. Tous les faits humains peuvent être représentés sous la forme d’une courbe de Gauss, mais choisir de considérer comme normal ce qui se rapproche de la moyenne ou au comme non anormal, original et fécond ce qui s’en éloigne, cela relève d’un choix de valeurs, autrement dit d’un choix de normes. L’identique et le différent sont un couple de contraires liés dialectiquement, et la vie n’est pas autre chose que cette liaison même. Autre chose est la question de la monstruosité : ultérieurement, dans un article intitulé « La Monstruosité et le monstrueux »[6], Canguilhem, après une brève mais suggestive histoire de la tératologie, soulignera que la véritable question en la matière est celle de la viabilité, avec comme corollaire celle de l’imagination come faculté de s’affranchir, dans le fantasme, des règles et de l’ordre qui caractérisent les déterminismes naturels.
La difficile prise en compte du pathologique
L’extrême diversité des pathologies a masqué l’unité du pathologique. On a eu l’idée qu’il y avait des essences pathologiques comme il y a des espèces naturelles. Cette création d’entités fictives à partir d’observations effectives, c’est ce qu’on peut appeler la conception ontologique de la maladie. On n’a pas manqué de remarquer que cette conception avait partie liée avec les grands succès de l’histoire naturelle au XVIIIe siècle[7]. Des classifications nosographiques ont été faites, parfois sous la forme pittoresque d’arbres avec leurs rameaux, relevant davantage du muséum que de la médecine[8]. Canguilhem juge sévèrement ces entreprises de classification : non seulement elles éloignent de la clinique, en méconnaissant que toute maladie est la maladie d’un malade, mais aussi, et peut-être plus gravement, en conférant une sorte de privilège ontologique aux données repérables et bien circonscrites sur lesquelles une intervention technique (ablation ou autre) est envisageable. La maladie est apparue, dans les cas les moins graves, longtemps soit comme un « plus » à ôter, soit comme un « moins » à combler, et dans les cas les plus graves, comme une « possession » sur laquelle la médecine n’a pas ou peu de prise. Au « bobo » localisé la technique, à la « vraie » maladie l’impuissance et la peur.
Canguilhem cherche moins à résoudre cette difficulté qu’à déplacer la problématique : pour la médecine, les sciences positives fournissent un ensemble d’outils et ouvrent à chaque moment de leur histoire des possibilités nouvelles à la thérapeutique et à la chirurgie, mais ces possibilités supposent une évaluation. Elles ne peuvent s’actualiser que par rapport à des normes auxquelles le médecin a la tâche de les subordonner. Entre la théorie et la thérapeutique, le rapport ne saurait être d’application mécanique, mais un rapport d’utilisation finalisée par ce que le praticien, le malade et plus généralement la société. Les techniques médicales se placent ainsi, pour partie, dans le prolongement des fonctions naturelles qu’elles suppléent ou imitent, et pour partie résolument en dehors d’elles ‘la chirurgie cardiaque du bypass, par exemple).
Anomalie, anormalité, milieu
Canguilhem remarque que, quelles que soient leurs oppositions, les doctrines médicales ont été d’accord sur un point : toutes se représentent la santé comme quelque chose de bien connu, qui ne pose pas de problème. Un dogme s’est imposé, de Comte et Broussais jusqu’à Leriche en passant par Claude Bernard : la maladie est une déformation ou une déviation de l’état normal. C’est ce que signifie le « principe de Broussais », qui pour penser le pathologique produit le concept d’irritation. Pas de différence de nature entre le normal et le pathologique, donc. Canguilhem rejette une telle conception : qu’est-ce au juste que la « normalité » ?
L’étymologie nous renseigne à ce sujet, et la clinique le confirmera : une anomalie (a-nomos en grec) est un écart par rapport à un « nomos », c’est-à-dire à une régularité habituellement constatée dans la nature. Elle revêt un caractère de rareté. Quelques personnes ont le cœur situé à droite, c’est une anomalie qui ne lèse en rien leurs possibilités de vie. Il arrive que ces anomalies restent inconnues du sujet lui-même. De la même façon, un pied-bot ou un bec de lièvre ne menacent pas l’espérance de vie biologique. Par contre, l’anormalité suppose la référence non pas à un nomos, mais à une « norma », mot qui en latin signifie une équerre, et qui implique non pas le simple constat d’un écart, mais l’exigence qu’il n’y ait pas d’écart. On sait ce que c’est qu’une norme de fabrication. Un bâtiment, un objet technique fabriqué en série, doivent être aux normes. Mais qu’est-ce pour un vivant, et singulièrement pour un vivant humain, que ne pas être aux normes [9]?
Évidemment, entre l’anomalie et l’anormalité, il existe de nombreux cas intermédiaires. Canguilhem s’attarde sur celui de l’hémophilie, où il voit plutôt une anomalie : idéalement, l’hémophile devrait pouvoir vivre une vie normale, si justement la « vie normale » n’était pas aussi une « vie animale », avec l’exposition inévitable aux chocs et aux blessures. Ainsi s’esquisse toute une problématique du handicap, qui met en question les capacités de la société à compenser ou simplement à accepter des différences qui ne menacent pas le vivant individuel en lui-même.
Et une société sera jugée par rapport à cette capacité de ne pas soumettre les êtres vivants à des normes excluantes ou appauvrissantes. Sans même parler de l’eugénisme nazi[10], Canguilhem s’en prendra vigoureusement au taylorisme[11] : la rationalisation qui asservit l’être humain au travail n’a rien de raisonnable. « … L’ambition de traiter l’homme comme objet de la rationalisation et de l’organisation scientifique du travail se heurte à un donné vital, puis psychologique et enfin sociologique. » Et plus loin : « Le milieu ne peut imposer aucun mouvement à un organisme que si cet organisme est d’abord au milieu selon certaines orientations propres. Une réaction forcée est toujours une réaction pathologique. » Le taylorisme et ses différents avatars ont méconnu jusqu’à l’absurde le fait que les êtres humains au travail aspirent à être, non pas des objets dans un milieu de contrainte mais sujets dans un milieu d’organisation. Taylor aurait intimé à ses ouvriers l’ordre de « ne pas penser : « Il est certes désagréable pour les entreprises que les hommes pensent, souvent sans qu’on le leur demande et toujours quand on le leur interdit », répond sarcastiquement Canguilhem.
Un humanisme de type nouveau
Ces considérations débouchent sur une philosophie de la santé. Canguilhem la conçoit comme une « allure », thème majeur dans sa philosophie : l’allure, c’est la façon dont un être humain produit et reproduit son rythme propre, développe ses capacités, réussit à compenser telle ou telle déficience biologique, grâce par exemple à un aménagement technique, matériel ou immatériel[12]. Encore faut-il que son milieu social lui en donne les moyens. Toute une tradition culturelle et pédagogique enjoint à l’individu de « s’adapter » : nous avons déjà souligné combien dès l’origine Canguilhem récuse ce dogme érigé en lieu commun pédagogique et politique. La véritable question n’est-elle pas, à l’inverse, celle de l’adaptation du milieu, que ce soit celui de l’entreprise, de l’école et même du système de soins à la diversité foisonnante des individus et de leurs allures, de façon à ce que chacun puisse épanouir ses possibilités propres et accéder à celles que le genre humain a accumulé sous forme de patrimoine social au long de son histoire ? « S’il est vrai que l’homme est le produit des circonstances, il faudra former les circonstances humainement »[13], disait déjà Marx.