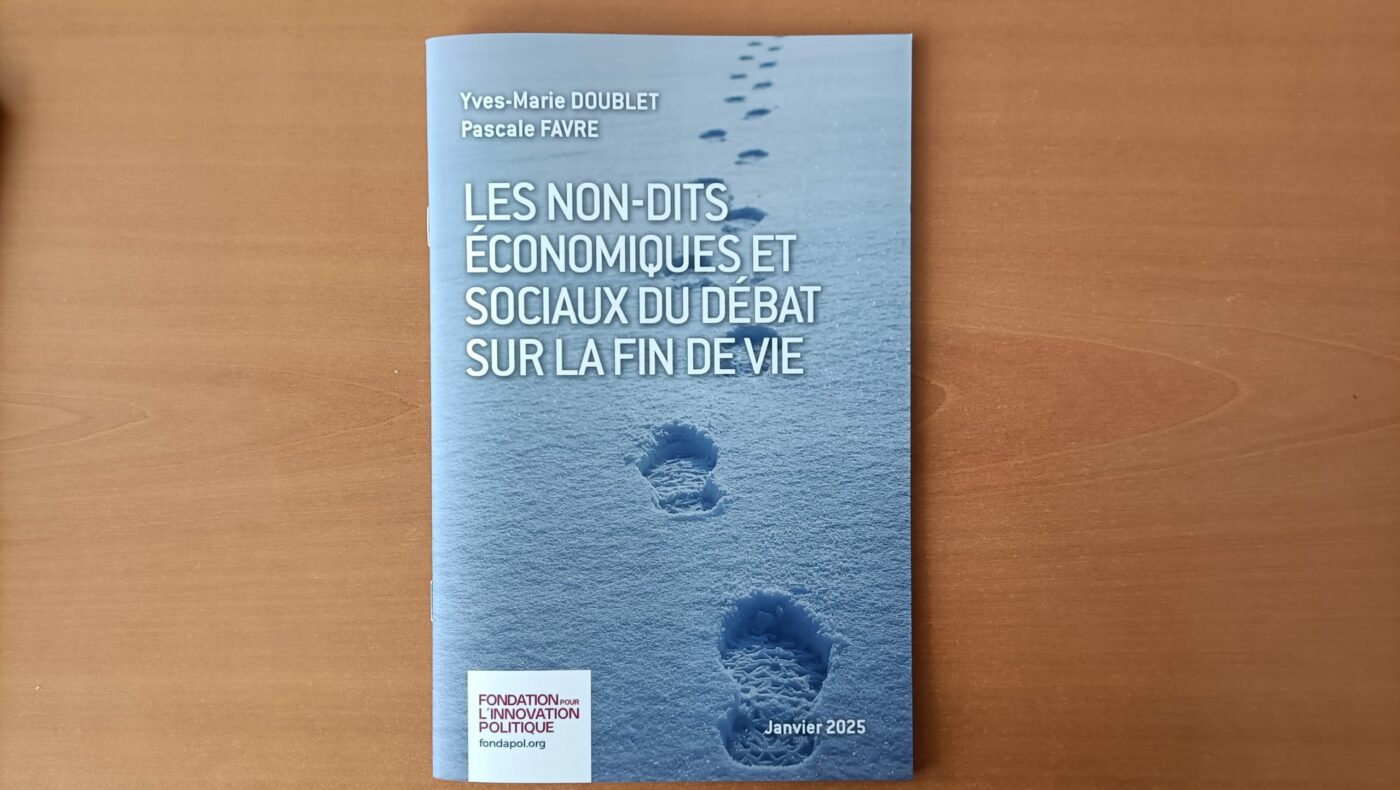Les non-dits économiques et sociaux
Un article de la « Fondation pour l’Innovation Politique » a attiré notre attention. Fondapol est un think-thank ou encore, en bon français, un laboratoire d’idées, qui se décrit ainsi : libéral, progressiste et européen. La Fondapol a été créée en 2004 par Jérôme Monod, un proche de Jacques Chirac. Reconnue d’utilité publique, elle bénéficie de subventions publiques et privées.
Ce document fut publié en janvier 2025 et élaboré par Yves-Marie Doublet, docteur en droit et chargé d’enseignement à l’espace éthique de l’Assistance Publique, et Pascale Favre, médecin, titulaire d’un DEA en droit et économie de la santé et doctorante en philosophie. Ce texte remet en cause la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté, invoquant, comme son intitulé l’indique : « Les non-dits sociaux et économiques du débat sur la fin de vie ».
Après avoir décrit une société française vieillissante, marquée par l’état alarmant du système de santé et le sous-investissement dans les soins palliatifs, l’article introduit le premier non-dit économique. Celui-ci a trait à l’idée que le développement de la mort provoquée pourrait être une source d’économies ; d’ailleurs les auteurs soulignent que la légalisation est soutenue par des complémentaires santé, telles que la MGEN.
Le second non-dit social concerne le profil des personnes ayant recours à ces dispositifs. Dans certains pays où le suicide assisté ou l’euthanasie ont été mis en place depuis plusieurs années, seraient surreprésentées les personnes isolées ou défavorisées.
Avant d’étudier les arguments développés dans cet article, revenons, dans un premier temps, sur les caractéristiques de la loi de 2016, dite loi Clayes-Leonetti. C’est, en effet, toujours cette législation qui régit actuellement la fin de vie. Ensuite, nous retracerons les débats concernant l’euthanasie ou le suicide assisté qui ont agité depuis 2017, aussi bien la société civile que les représentants politiques. Une façon de souligner la gravité des questions qui émergent lorsqu’on évoque la fin de vie et la difficulté à trouver des réponses. Ce débat convoque la Médecine, mais aussi la Philosophie et la Sociologie. En effet, si la plupart d’entre nous plébiscitons la nécessité de développer les soins palliatifs, en revanche, nous sommes beaucoup plus réticents à recommander l’euthanasie. Pourquoi ? C’est qu’elle représente une transgression d’ordre moral, éthique. C’est de l’interdit du meurtre dont il est question. Quelles sont les exceptions à l’interdit du meurtre ? C’est une question qui donne le vertige.
La loi de 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, d’initiative exclusivement parlementaire, a été nourrie par une longue réflexion en amont avec toutes les parties prenantes. Son adoption a fait l’objet d’un large consensus et a été votée, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, par une large majorité. Cette loi pose le principe selon lequel toute personne a droit à une fin digne et apaisée et, de ce fait, proscrit l’obstination déraisonnable. Est qualifié d’obstination déraisonnable un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que le seul maintien artificiel de la vie.
Ce texte accorde une prééminence à la volonté des patients à travers plusieurs avancées : les directives anticipées qui s’imposent aux médecins, le statut accordé à la personne de confiance et enfin le droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès pour le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, c’est-à-dire, en l’espace de quelques heures ou de quelques jours, qu’il puisse exprimer ou non sa volonté. Cette sédation se distingue de l’euthanasie par son intention, les moyens en jeu, la procédure applicable, son résultat, et la temporalité dans laquelle elle s’inscrit.
Dès 2017, le député Olivier Forlani, membre du comité d’honneur de l’Association du Droit à Mourir dans le Dignité (ADMD) dépose un projet de loi pour favoriser « l’aide active à mourir ». Il pense que l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation peut placer le patient dans une situation qui est susceptible de durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qu’elle n’est pas humainement tolérable. Par ailleurs, selon lui, la sédation profonde et continue ne règle pas tous les cas médicaux et il évoque les pathologies suivantes : Maladie de Charcot, sclérose en plaques ou cancers généralisés. Si les patients souhaitent abréger leur vie, la loi doit leur permettre d’accéder à l’aide active à mourir. Cette proposition de loi n’est adoptée par la commission des affaires sociales qu’en 2021, soit quatre ans plus tard, sous le titre : « Loi à une fin de vie libre et choisie ». Elle est soutenue par des élus de toutes tendances politiques. Son examen sera bloqué dans l’hémicycle par l’obstruction de cinq députés LR, lesquels, à eux seuls, ont déposé près de 2500 amendements.
D’autres textes connaissent un sort similaire : C’est le cas de la proposition de loi relative à « L’euthanasie et au suicide assisté pour une fin de vie digne ». Déposée par la députée de la France Insoumise Caroline Fiat, elle fut rejetée en commission en 2018. De même, le projet, proposé au Sénat par la sénatrice Marie-Pierre La Gontrie en novembre 2020, sera retiré de l’ordre du jour.
Lors de la campagne des élections présidentielles de 2022, le candidat Macron a promis de faire examiner un projet de loi sur l’aide à mourir. Après sa réélection, redoutant que le sujet ne déchaine les passions, le Président reporte son examen lequel est programmé après les élections européennes.
S’appuyant sur l’avis du Comité consultatif national d’éthique rendu en 2022 et celui de la Convention citoyenne sur la fin de vie de 2023 – les deux instances se déclarent favorables à une « aide active à mourir » strictement encadrée -, le Président détaille en mars 2024, lors d’une entrevue exclusive donnée aux journaux « La Croix » et « Libération », les principales mesures du projet de loi.
Les réactions furent nombreuses et diverses : médecins, soignants, parlementaires, religieux, responsables associatifs et militants du droit à mourir dans la dignité apparaissent comme très divisés. Si la présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie salue l’« équilibre » du projet, la plupart des autres avis sont hostiles ; les uns se sentent floués par le recours à l’aide à mourir, euthanasie inavouée qu’ils combattent ; à l’inverse, d’autres, au contraire, favorables à l’aide active à mourir, dénoncent ce texte qui ne « va pas assez loin et dont les conditions trop restrictives n’accordent pas aux patients la liberté de choix ».
Présentés fin mai dans un hémicycle où les débats, très riches, se sont déroulés dans une ambiance d’écoute et de respect, les premiers articles de loi furent votés à la majorité. Avait été ainsi adopté le renforcement des soins palliatifs. A souligner que les parlementaires, contre l’avis du gouvernement, ont voté un amendement visant à garantir un accès aux soins palliatifs par un droit « opposable ». Ensuite, fut adopté l’article rendant possible le recours à l’aide à mourir. Comme on le sait, la dissolution de l’Assemblée nationale a annulé les votes déjà intervenus et a empêché le vote solennel de la loi lequel était prévu mi-juin.
La dernière péripétie de ces tentatives de légiférer sur l’accompagnement des personnes en fin de vie, c’est le coup de théâtre de l’annonce, par son entourage, de la position du nouveau Premier ministre nommé en décembre 2024. Contrairement à son prédécesseur le malheureux Michel Barnier, lequel avait décidé de reprendre le projet de loi là où il avait été interrompu, François Bayrou entend adopter une autre position. Il souhaite scinder en deux le projet de loi sur la fin de vie. Il n’y aurait donc plus un seul projet, mais deux propositions de loi ; l’une, consacrée aux soins palliatifs et l’autre dédiée à l’aide à mourir. Il compte donc aborder séparément le sujet, clivant, de la fin de vie, et celui des soins palliatifs, plus consensuel. Cette initiative apparaît comme un revers pour les partisans d’une aide légale à mourir et a suscité la désapprobation de la présidente de l’Assemblée nationale tout comme celle d’Olivier Forlani lequel a exprimé son ferme désaccord. En revanche, pour le président de la Conférence des évêques de France, c’est « une mesure de sagesse ».
Il semblerait à l’heure actuelle que les deux propositions de lois distinctes seront portées par deux parlementaires différents. L’examen de ces deux textes se ferait simultanément et serait discuté avant la fin de la session ordinaire, soit avant le 30 juin prochain.
Mais, revenons à l’article que nous souhaitions commenter.
Le premier chapitre détaille la dégradation du système de santé : offre de soins qui ne répond pas aux besoins, prises en charge déficientes de la douleur, du vieillissement, des pathologies psychiatriques. L’inégalité des soins en médecine palliative est dénoncée en terme qualitatif et géographique. Enfin, les deux auteurs décrivent l’effet anxiogène qui s’abat sur les soignants à l’annonce de la légalisation de la « mort provoquée ».
Si nous sommes bien en accord avec la description de l’état alarmant de notre système de santé, nous n’oublions pas que ce sont les députés de droite, proches de la Fondapol, qui ont fait subir au système de santé des cures d’austérité pendant des décennies. Ils ont eu recours à une modification de la Constitution pour que ce soit l’Assemblée nationale qui vote le financement de la Sécurité sociale avec le PLFSS ou Projet de loi sur le financement de la Sécurité sociale ; ils ont instauré l’Objectif national des dépenses de l’assurance maladie ou ONDAM. Les mêmes ont créé la rémunération à l’activité ou T2A, mode de financement unique des établissements de santé publics et privés, ce qui a fragilisé l’hôpital public, ils ont favorisé les exonérations de cotisations sociales au bénéfice des entreprises ce qui assèche les ressources de la Sécurité sociale. Il est donc grand temps pour eux de s’inquiéter des conséquences de ces choix éminemment politiques, d’inspiration libérale…
Il est tout à fait juste, néanmoins, que l’adoption de l’aide active à mourir pourrait nuire au développement des soins palliatifs aussi bien dans l’hexagone qu’en outremer.
En revanche, quand ce même article impute le désarroi des soignants au projet de loi débattu depuis deux ans autour de la mort « programmée » ou « provoquée », la mauvaise foi de nos deux auteurs se révèle. En premier lieu, soulignons le vocabulaire employé : le projet de loi déposé en 2024 évoquait une « aide à mourir » et non pas une mort « programmée » ou « provoquée ». Cette dernière expression est péjorative et est utilisée à escient, en pleine connaissance de cause. Ensuite, malheureusement, depuis la pandémie Covid 19, on a assisté à de nombreuses démissions de soignants. Sont en cause, plutôt que ce projet de loi, la charge de travail du fait d’effectifs insuffisants, la perte de sens d’un métier où l’on n’a plus de temps pour l’empathie et aussi les salaires insuffisants. Soulignons, cependant, que les médecins travaillant dans les unités de soins palliatifs, à l’instar du Dr Claire Fourcade, présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), sont partagés par ce projet de loi : “Je suis médecin en soins palliatifs, j’accompagne des patients en fin de vie, je fais de l’aide à mourir au quotidien, mais ce que propose le président, c’est un projet de loi pour faire mourir, un projet de loi euthanasie et suicide assisté sur décision médicale”, déplore-t-elle.
Dans la deuxième chapitre de l’article, est décrit ce que les auteurs nomme le premier non-dit. Sont évoquées plusieurs dérives qui auraient été constatées au Canada et aux États-Unis. Depuis 2021, le Canada a élargi, en supprimant le caractère prévisible de la mort comme préalable, les conditions pour recourir à l’euthanasie dont la légalisation avait été votée en 2016. D’après nos deux auteurs, Il s’agit, pour la société canadienne, d’un choix assumé pour réaliser des économies substantielles. Un parallèle est établi avec l’insuffisance de développement des soins palliatifs dans ce pays. Suit une assertion sur la banalisation de l’euthanasie dans la société canadienne et notamment québécoise, ainsi que la phrase suivante, particulièrement choquante : « Le Canada semble appliquer l’euthanasie pour des raisons sociales quand les gens n’ont pas les moyens financiers ».
En fait ces allégations sont balayées par deux avocats canadiens spécialistes du droit de la santé, Me Patrick Martin-Menard et Me Jean-François Leroux. Ils dénoncent des articles mensongers relayés par des sites d’information liées à la religion et farouchement hostiles à l’euthanasie. Contrairement aux allégations proférées par certains médias, il n’est pas si simple de recevoir une aide médicale à mourir au Canada. La demande doit être acceptée par deux médecins différents et l’encadrement juridique est tout à fait strict. D’après ces deux avocats, les problèmes sociaux ne permettent, en aucun cas, d’accéder à l’aide médicale à mourir.
Doublet et Favre calquent sur la situation française le constat des économies réalisées au Canada pour démontrer que l’on pousse dans notre pays à « la mort provoquée » plutôt qu’au développement des soins palliatifs pour diminuer « le coût de la fin de vie ». Une phrase évoque même que nous pourrions suivre l’exemple du Quebec où « il est proposé aux patients atteints d’une maladie grave le choix de l’aide médicale à mourir dès l’annonce du diagnostic ». Des cas auraient été rapportés de patients qui l’auraient demandée quelques jours après le diagnostic. Une seule source est citée : c’est le nom d’Alain Gravel est cité : un animateur de radio-télévision.
Enfin, le second non-dit concerne le profil socio-économique des personnes qui y ont recours. D’après nos deux auteurs, aux États Unis, en Oregon, ainsi qu’au Canada, en Ontario, les personnes pauvres seraient surreprésentées. En fait, diverses études internationales démontrent l’inverse. Ainsi, en Oregon, le rapport annuel nous apprend que “près de la moitié” des morts par suicide assisté en 2023 “avaient un diplôme de niveau licence ou supérieur”. Or, les catégories les plus éduquées s’avèrent aussi être celles qui affichent les revenus les plus élevés. On peut donc avancer que ce sont les plus aisés, et non les plus pauvres, qui se tournent davantage vers l’aide à mourir dans l’Oregon, comme le conclut d’ailleurs un autre think tank ou laboratoire d’idées français, le bien connu Terra Nova. Une autre étude indique que dans les neuf Etats américains disposant de données publiques sur les bénéficiaires de l’aide médicale à mourir, « nous avons découvert une surreprésentation des individus très éduqués, une variable qui peut être associée au statut socio-économique ». Enfin, au Canada, et en Otario, précisément, l’auteur principal d’une étude James Downar indique: « Les personnes qui bénéficient de l’aide médicale à mourir (…) sont généralement des gens bien nantis, privilégiés ».
Ce qui est troublant à propos de ces allégations, c’est qu’au moment où l’examen du projet de loi commençait à l’Assemblée nationale fin mai 2024, plusieurs personnalités hostiles à l’aide active pour mourir ont dénoncé ces soi-disant inégalités : “Quand on est pauvre, oui, la fin de vie est plus difficile que quand on est riche. Et, oui, cela peut inspirer des idées d’en finir”, a avancé le député LR Philippe Juvin, lundi 27 mai, au premier jour de l’examen du texte. Le dynamique chef des urgences de l’hôpital parisien Georges-Pompidou, qui redoute que cette loi s’applique “essentiellement à des gens vulnérables, pauvres et isolés”, a interpellé ses collègues parlementaires au sujet des suicides assistés aux États-Unis : “Posez-vous la question : pourquoi, dans l’Oregon, la majorité des suicidés sont parmi les plus pauvres? “. Avant d’admettre, un peu plus tard, qu’il avait mal interprété une étude qui lui avait été remise.
Le même 27 mai, dans les colonnes du Figaro, la députée Astrid Panosyan-Bouvet citait aussi la situation Outre-Atlantique. “Au Canada et en Oregon, ce sont les patients d’un niveau de vie modeste qui ont tendance à réclamer l’aide à mourir”, affirmait l’élue Renaissance. Le lendemain, sur LCP, au tour du député LR Yannick Neuder : “Quand on regarde le recours au suicide assisté, on s’aperçoit que c’est beaucoup des personnes qui sont dans des difficultés socio-économiques importantes.”. Il s’agit là d’un tir groupé des députés hostiles à la loi, qui ont divulgué une information, sans avoir contrôlé leurs sources. Ce qui est étonnant, c’est que nos deux auteurs, en janvier 2025 aient repris ces propos, alors que Philippe Juvin avait reconnu son erreur dès juin 2024. Ce sont donc des prises de position excessives de militants défendant une idéologie. Alors que bien d’autres arguments peuvent être défendus pour exprimer des doutes sur le bien fondé de légaliser l’aide à mourir.
Notamment, nous retiendrons l’intervention de Pierre Dharréville, député communiste de 2017 à 2024 qui a présenté, en 2024, les raisons qui le poussaient à ne pas voter les articles de loi prévoyant l’aide active à mourir. Sa position est d’autant plus intéressante qu’elle divergeait de celle des parlementaires de gauche, en général, et de celle de son groupe, en particulier. Les élus de son groupe ont souhaité qu’il apporte au débat les interrogations qui les traversaient toutes et tous, même si les réponses apportées pouvaient être différentes. Pierre Dharréville évoque la colère qui le prend quand il constate que, faute de moyens, seulement une personne sur deux, qui relèvent des soins palliatifs, n’y accède. Alors que la société ne tient pas sa promesse d’accompagner chacun dans l’ultime épreuve, la loi, au lieu d’envoyer un message d’attachement, d’encouragement, poserait la question : « Ne crois-tu pas qu’il est temps de partir ? ». Comme Philippe Juvin, qu’il rejoint sur ce point, il s’émeut que « des patients puissent plus rapidement avoir accès à un produit létal plutôt qu’à un centre anti douleur ». Regrettant que nous ne vivions pas dans une République sociale, il indique qu’il ne veut pas d’une telle société, qui légifère au mépris de la solidarité et de la fraternité. Au total, à une étude économique et sociale du débat sur la fin de vie dont on a montré que la fiabilité n’est pas assurée, je préfère des arguments qui font appel à notre humanisme et aux principes d’égalité et de fraternité qui doivent nous animer.
Y.-M. Doublet, P. Favre, Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie, éd. Fondation pour l’innovation politique, janvier 2025.