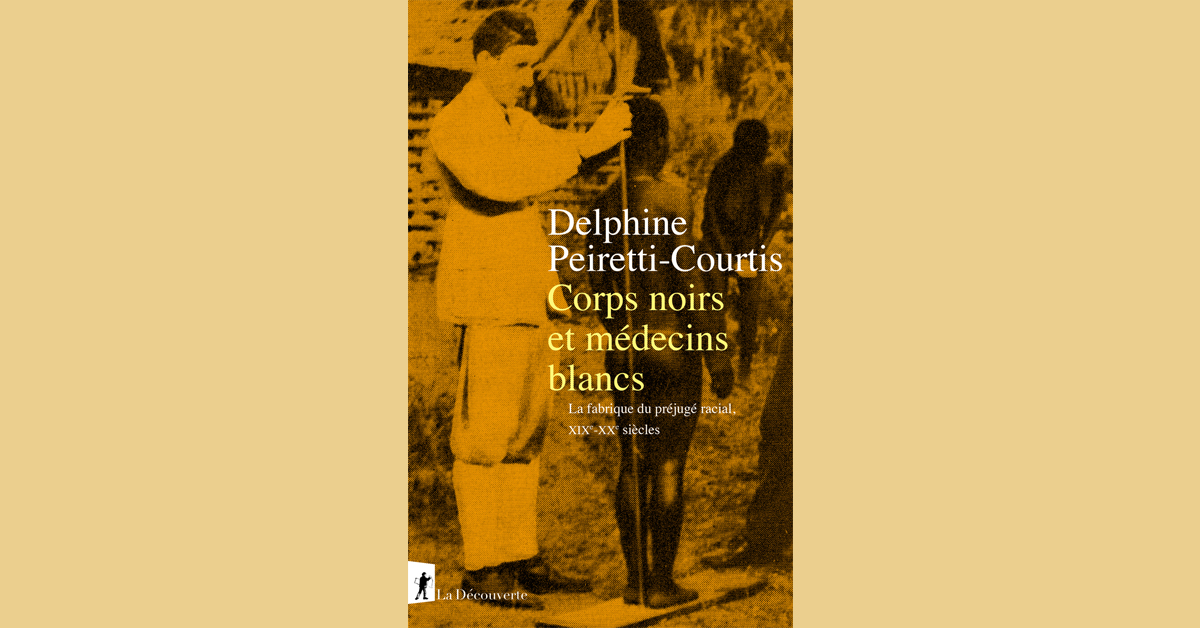Dans cet ouvrage, Delphine Peiretti-Courtis historienne et enseignante à l’université d’Aix-Marseille passe sous le scalpel les stéréotypes racistes à l’égard des femmes et hommes noirs. Des cas emblématiques comme les cris de singes lancés contre les footballeurs noirs dans les stades aux expressions moins blessantes ou paternalistes, l’autrice révèle au fil des pages leurs généalogies. Grâce à ce travail archéologique, on découvre comment la littérature médicale française à partir du milieu du XVIIIe et ce jusqu’aux années 1950 a donné une caution scientifique à tous les préjugés concernant les noirs : infériorité intellectuelle, résistance physique, prédominance des émotions ou encore hypersexualité. Les sources que mobilise Delphine Peiretti-Courtis sont les documents d’époques : dictionnaires et traités médicaux, monographies sur les races humaines, rapports de missions coloniales. Cette enquête, une première du genre en l’occurrence, documente ainsi l’apparition dans les sciences médicales françaises des théories raciales appliquées aux populations africaines, puis leur propagation avant leur déclin. L’historienne dans cet ouvrage qui fera sans doute date, dissèque avec une précision de microchirurgie les processus de racialisation des corps, du genre et de la sexualité des peuples d’Afrique. L’association de la pigmentation de la peau et les caractères prêtés aux noirs africains.
Dans cet essai fouillé et extrêmement bien documenté, elle montre l’historicité des préjugés raciaux à travers leur construction scientifique. On y découvre comment les scientifiques ont, du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle, donné caution à une vision racisée et hiérarchisée de l’humanité. De même les liens entre ce paradigme scientifique et le contexte de l’esclavage et de la taxinomie du vivant. Ce travail s’insère dans une historiographie autour de la construction du racisme scientifique à l’époque coloniale et s’intègre aux recherches sur l’intersectionnalité ou les mécanismes croisés de construction des stéréotypes de race, de sexe et de genre.
L’ouvrage est divisé en trois parties suivant un ordre chronologique. De la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle, Delphine Peiretti-Courtis en distingue trois. La première (1780-1860) rend compte de la rencontre avec l’altérité africaine et la construction des stéréotypes. Pendant longtemps si les populations africaines sont perçues comme étant de couleur noire, l’essentialisation de la pigmentation de leur peau est historiquement datée. C’est lorsque la traite négrière et l’esclavage se mettent en place, que le corpus idéologique qui associe la couleur de la peau l’infériorité sociale et rend « naturelle » l’idée d’asservissement prend forme. La partition de la science anthropologique, médicale et racialiste a consisté au cours du XIXe siècle à rattacher à la pigmentation de la peau des caractéristiques physiques, morales et cognitives considérées comme innées. Le crâne et le visage africains sont scrutés. La nudité, la sexualité sont l’objet d’investigations et d’interprétations renvoyant le plus souvent à la sauvagerie, la démesure ou la difformité. La deuxième phase qui va de 1860 à 1910 est caractérisée par l’influence des impératifs en lien avec les intérêts coloniaux dans l’exécution des projets scientifiques. L’anthropométrie fait son apparition, les muscles, les os et le squelette sont mesurés sur le vivant comme sur les cadavres. C’est également au cours de cette période qu’émergent les travaux sur « les pathologies des peuples ». Les corps intéressent les médecins dans une triple perspective : sanitaire, scientifique et politique. Existe-t-il une immunité différentielle entre Noirs et Blancs ? Voilà une question qui constituera le fil conducteur dans la construction des préjugés sur les races et la construction de théories raciales. La troisième partie qui couvre la période 1910-1960 marque le déclin des théories racistes. La diversité humaine est de plus appréhendée par les scientifiques et les médecins sous le prisme de la culture. Ce changement de paradigme doit beaucoup à l’apport des sciences sociales notamment la sociologie, la psychologie sociale ou la psychanalyse. Il n’en a pas pour autant empêché que ces « savoirs » scientifiques soient encore ancrés dans les esprits.