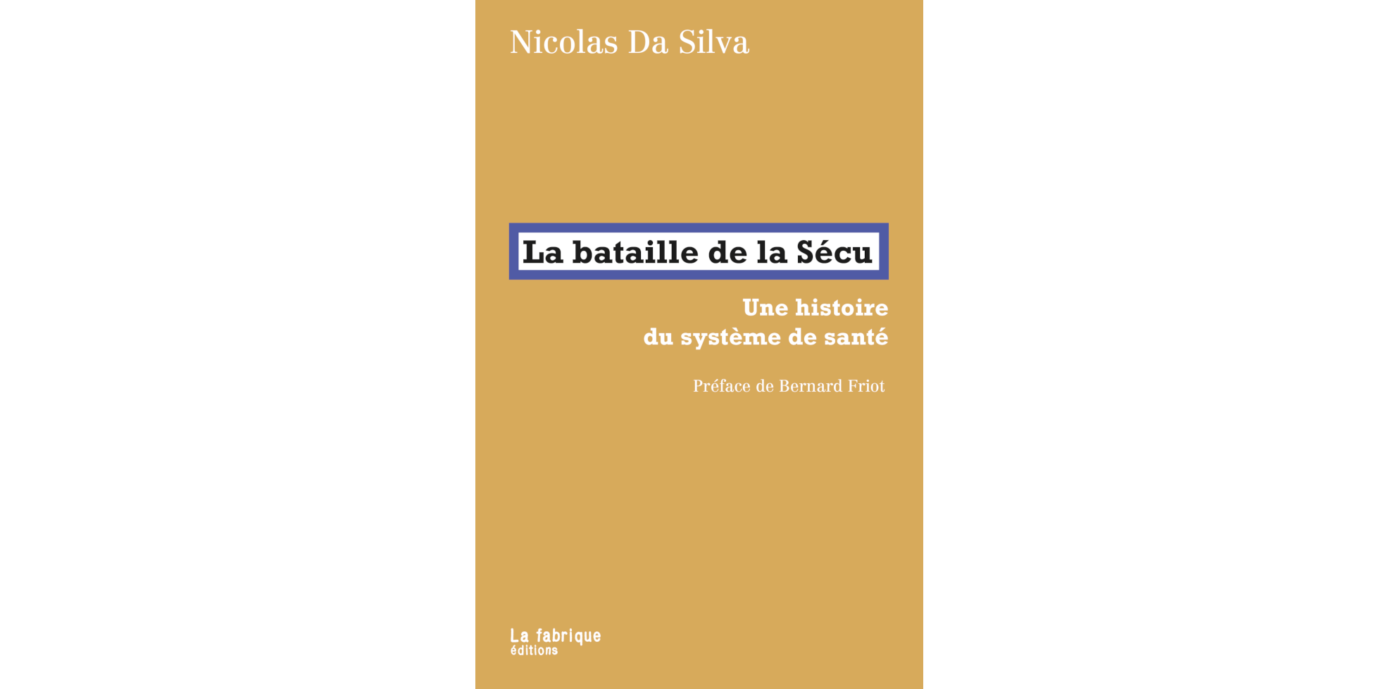L’auteur est Nicolas Da Silva maître de conférence en sciences économiques à l’université Sorbonne Paris Nord. Son ouvrage oppose deux logiques en matière de sécurité sociale : celle de «l’État social» par lequel le capitalisme d’État s’empare pleinement de la gestion du système de santé et de protection sociale et celle de «La sociale» où le système est porté par les bénéficiaires eux-mêmes et leurs mandants. D’autres différences opposent ces deux logiques comme l’existence ou non d’une couverture universelle ou celle d’une production santé publique ou par le capital.
Ce livre dense qui se veut à dimension historique, connaissance essentielle pour l’auteur retrace l’histoire des institutions de soins, depuis le féodalisme. La révolution française, en dissolvant les rapports féodaux a mis à mal, les solidarités familiales et villageoises comme les moyens de l’église, support des hospices charitables pour les pauvres. En même temps cette révolution bourgeoise a contribué à initier la notion de droits sociaux face à la charité octroyée de l’ancien régime. Sa radicalisation à partir de 1793, s’appuyant sur le peuple, a tenté de faire voler en éclat les privilèges et a avancé sur les prémisses d’un droit à la santé même si thermidor y a mis fin. Au 19e siècle, la situation sanitaire de la population s’est aggravée, le capitalisme en plein développement emporte la détérioration des conditions de vie et de travail, les besoins sont énormes. L’interdiction des coalitions au profit de la liberté d’entreprendre, laisse un passage étroit aux sociétés ouvrières d’entraide mutuelles, au travers desquelles va s’affirmer la contestation. La mutualité et les assurances se développent, mais le système est repris en main en grande partie par l’état et les notables et industriels, alors que les syndicats sont toujours interdits jusqu’en 1884 ; la Mutualité sera florissante. Elle obtiendra de participer à la gestion des premiers systèmes de protection sociale mis en place juste avant et après la grande guerre à laquelle l’auteur associe la notion de guerre totale (celle qui engage tout le peuple) qui déclenche l’action de «l’État social».
Et c’est aussi la situation de conflit qui, avec la résistance, fonde en 1945 la légitimité de «La Sociale», auto-organisation de la protection sociale, anti-paternaliste, héritière des principes de 1793 et des sociétés de secours mutuel ouvrières, un système qui échappe au capital et à ses soutiens. La construction de la Sécurité sociale, loin de la légende d’une unanimité nationale a été conflictuelle et il a fallu toute la force et la pugnacité des militants de la CGT et du PCF pour parvenir en 1946, à la mettre en marche. La suite est connue, l’État comme le patronat ou le corps médical, l’église, appuyés par la Mutualité française et la division syndicale, n’auront de cesse de remettre en cause ces fondements.
L’auteur rappelle que dès le début, les adversaires de «La Sociale» profèrent les mêmes accusations qu’aujourd’hui, déficits, fraudes, allongement de la durée de la vie pour la retraite et exigent la reprise en main par l’État, le retrait de la gestion des mains de ces gens incapables, les travailleurs. Pourtant, il le démontre, ce régime a montré son efficacité dans la modernisation du système de soins en dehors des contraintes de l’État et du capital. Petit à petit les textes, ordonnances de 1958, ordonnances de 1967, création de la CSG en 1990, ont acté un processus de modification des pouvoirs, des rôles et des conditions financières de son fonctionnement. La réappropriation par l’État a franchi un pas décisif avec le plan Juppé, en 1995-1996, création d’un budget de la sécu, des enveloppes contraintes (ONDAM), de la CADES qui soumet la dette sociale aux marchés financiers, création des Agences Régionales de l’Hospitalisation qui ont tout pouvoir sur les budgets des hôpitaux et la carte sanitaire. L’État est désormais quasi seul aux postes de commandes, avec l’élite du «welfare» hauts fonctionnaires, adeptes du «paternalisme de l’expertise» qui appliquent sa politique et méprisent les représentants des assurés considérés comme des incompétents. Couper dans les dépenses sans se préoccuper des conséquences pour eux c’est facile, ils ne les subissent pas et en plus ils le font au nom de la préservation de la Sécurité sociale, au nom du ciblage des aides vers les plus démunis.
La part de la Sécurité sociale dans les dépenses de santé recule depuis les années 80 au profit des complémentaires santé, plus chères plus inégalitaires et bien moins solidaires, avec des restes à charge accrus. Cette évolution s’accompagne d’un recul de la production publique de soins, au profit du capital, dont l’entrée dans tous les secteurs, clinique laboratoires, pharmacie, est facilitée et sécurisée par les financements socialisés.
On voit aussi se développer une privatisation au sein même des structures de soins publiques, l’État imposant en outre une conception industrielle et comptable de la qualité des soins qui dépossède les soignants. La financiarisation du financement de la sécu et des hôpitaux comme de la gestion de leur dette profite aux marchés financiers et accroît les difficultés du système. L’argent public sert le capital.
Résultat: Recul de l’offre de soins publique mais aussi privée (déserts médicaux), restes à charges et dépassements d’honoraires qui limitent l’accès aux soins. Pour l’auteur, ces évolutions sont caractéristiques du capitalisme politique, l’État aidant au maintien des dominations économiques, à leur stabilité, leur sécurité. Le pouvoir ouvrier laminé ; à la sécu, il y a désormais les mains libres.
L’ouvrage se termine sur la pandémie, accélérateur du capital sanitaire, qui a démontré l’incapacité de «l’État social». Les sommes dépensées sur décision de l’État sont mises en grande partie sur le dos de la sécu, annonçant une nouvelle campagne idéologique sur «les déficits insupportables» et de nouveaux reculs…
En conclusion de cet ouvrage l’auteur explique que si «l’État social» semble avoir gagné ce qui est une vraie bataille de la sécu, cela signifie t-il qu’il n’a pas d’alternative à cette production du capitalisme ? Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas d’autre voie que la «conciliation» à l’intérieur de ce système triomphant ? L’auteur, au contraire, invite à relancer l’idéal de «la Sociale» et à reprendre le combat contre le capital et l’État qui le sert.
Cet ouvrage contient beaucoup d’informations et la thèse qu’il soutient est documentée. On note toutefois le peu de place réservée (dans l’ouvrage) aux mouvements sociaux, quoiqu’ils soient toujours présents en filigrane. On peut s’étonner aussi de la place considérable accordée au haut fonctionnaire Laroque, à qui est attribué le principe de gestion de la sécu par les intéressés, sans que soit abordée l’influence du CNR et quasiment pas le rôle du ministre Croizat. L’auteur oublie aussi quelques textes d’importance dans le process de déconstruction, par exemple le décret du 12 mai 60 et les pouvoirs confiés aux directeurs de caisse, la loi HPST de 2009 qui a tout de même permis au privé lucratif d’intégrer le service public hospitalier et a créé les ARS qui ont définitivement éliminé toute démocratie sanitaire !
S’agissant de la CSG il insiste peu sur le rôle transformateur de ce dispositif de financement qui élargit l’assiette aux pensions et allocations mais exonère le capital financier ou industriel. Enfin on a parfois du mal à cerner à quoi précisément l’auteur fait référence, par exemple au moment où il évoque la production de médicaments dérivés du sang et «les entreprises publiques para-capitalistes». En bref, un livre à lire et à débattre…