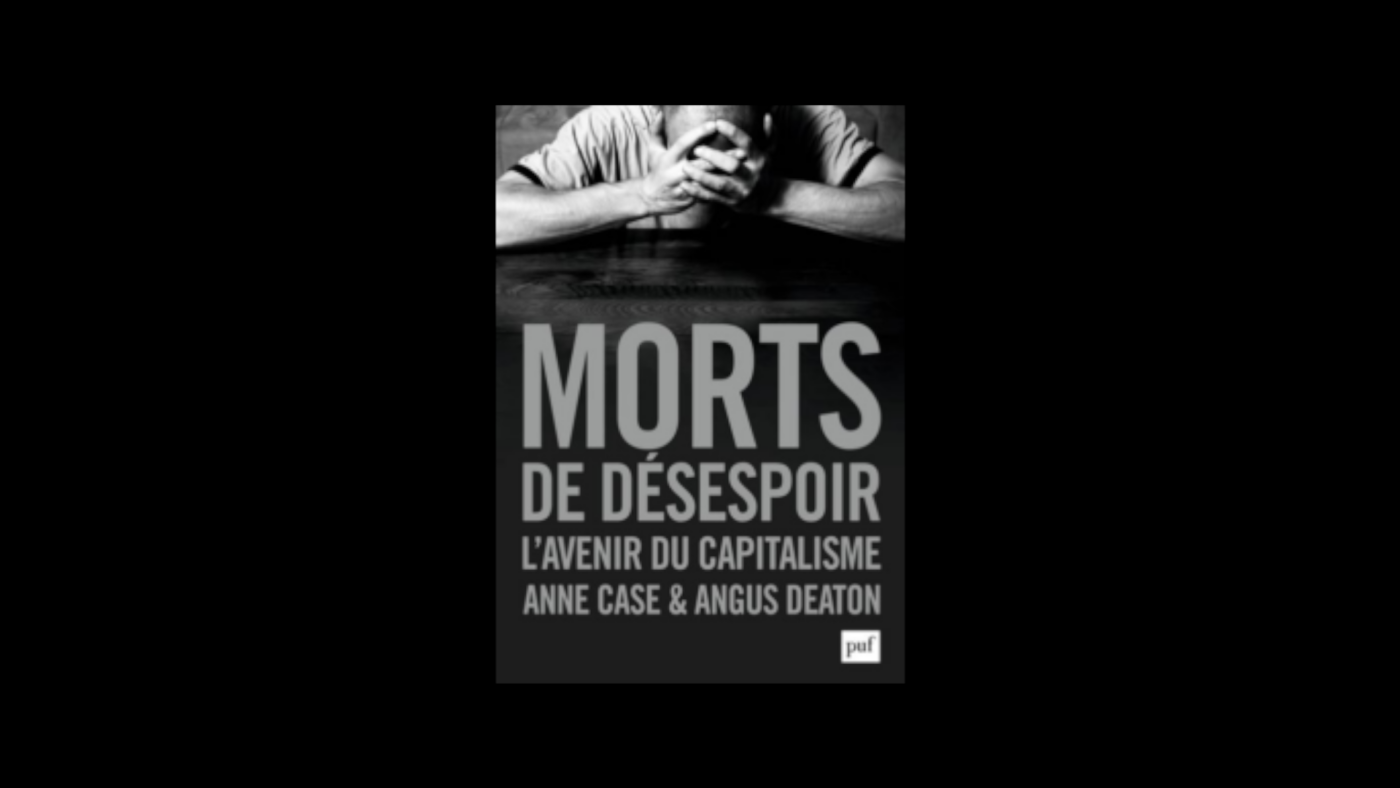C’est B. Pignon qui a attiré notre attention sur cet ouvrage. L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, après un premier mandat entre 2017 et 2021, est l’occasion de revenir sur un essai publié en 2020 aux États-Unis, qui explore un phénomène qui n’est pas étranger au vote pour Donald Trump : l’augmentation de la mortalité due à des événements accidentels ou violents aux États-Unis depuis la fin des années 1990. Les auteurs se penchent sur 3 de ces causes : les suicides, les intoxications (principalement aux opioïdes) et l’alcool ; des causes qu’ils regroupent sous l’appellation “morts de désespoir” (deaths of despair). Ce concept de « mort de désespoir » est à méditer. Cette augmentation, que les auteurs qualifient d’épidémie, touche particulièrement la population blanche non hispanique et de diplôme inférieur au master, population qui a massivement voté pour Trump. Les États les plus touchés par cette mortalité (tels que la Virginie-Occidentale, le Kentucky, l’Ohio ou le Wyoming), sont ceux qui, en 2016 comme en 2024 ont élu les grands électeurs républicains à une forte majorité.
Ce livre a été rédigé par 2 économistes, professeurs à l’université de Princeton : Anne Case, spécialiste de l’impact de l’éducation et des inégalités sur la santé, et Angus Deaton, Prix Nobel d’économie (2015) pour ses travaux sur la consommation, la pauvreté et le bien-être. Ils font dans un premier temps le constat d’une épidémie de morts spécifique aux États-Unis. Les chiffres sont édifiants, à commencer par le recul de l’espérance de vie, phénomène inédit depuis plus d’un siècle. Le phénomène d’allongement de la vie s’est interrompu dans la population des Américains blancs non hispaniques peu ou pas diplômés, avec un décrochage brutal à la fin des années 1990, qui n’est pas retrouvé dans les autres groupes. Les Afro-Américains, qui présentent historiquement une espérance de vie inférieure aux autres groupes des États-Unis, ont durant cette période une espérance de vie qui a continué de progresser, au moins jusqu’en 2013. Ainsi, depuis 1990, l’espérance de vie des Américains blancs peu ou pas diplômés se rapproche de celle des Afro-Américains. Cette mortalité (morts de désespoir) passe chez les Américains blancs âgés de 45 à 54 ans de 30 à 92 pour 100 000 entre 1992 et 2017. Chez les peu ou pas diplômés (inférieur au master), ce taux passe de 37 à 137 pour 100 000 entre 1995 et 2015 ; le risque est ainsi 3 fois plus élevé dans ce groupe (par rapport aux Américains blancs diplômés). Les femmes sont autant touchées que les hommes. Dans chaque État des États-Unis, les taux de mortalité des 3 types de mort de désespoir ont augmenté chaque année entre 1999 et 2017. De tels chiffres ne sont retrouvés dans aucun autre pays occidental. A. Case et A. Deaton mettent en parallèle ces chiffres de mortalité avec ceux d’indicateurs de santé, comme la détresse mentale ou la douleur physique. Ils montrent d’ailleurs les corrélations entre ces mesures et le vote en faveur de Trump.
Parmi les morts de désespoir, l’augmentation la plus importante concerne les overdoses aux opioïdes. Le nombre total de morts par opioïdes entre 2000 et 2017 dépasse celui des Américains morts pendant les 2 guerres mondiales ! Dans cette épidémie l’inaction des pouvoirs publics a joué un grand rôle, à commencer par celle de la Food and Drug Administration. Outre l’inefficacité de leur système de santé, les auteurs rappellent son coût énorme aux États-Unis, fardeau intolérable pour l’économie en général et pour les particuliers concernés – les plus modestes ne pouvant pas payer les soins nécessaires. Entre 1960 et 2017, le pourcentage du produit intérieur brut consacré aux soins de santé est passé de 5 à 18 %.
Même si l’augmentation est moins forte, les morts par suicide chez les Américains blancs non hispaniques peu ou pas diplômés augmentent également depuis les années 1990.
Les 2 économistes pensent que ces morts de désespoir reflètent un phénomène latent : la perte de tout un mode de vie pour la classe ouvrière blanche peu instruite, facteur déterminant dans les 2 élections de Trump. Elle est en lien avec les mutations du marché de l’emploi : entre 2010 et 2019, le nombre de diplômés employés a augmenté de 13 millions, tandis que ce chiffre n’a progressé que de 2,7 millions chez les peu ou pas diplômés. Les auteurs analysent un phénomène inédit de renoncement à l’emploi. Par ailleurs, parmi les employés, ils décrivent une dégradation des conditions de travail et l’essor des mauvais emplois. Les auteurs incriminent également l’absence de redistribution, avec même un phénomène de redistribution vers le haut : concentration des richesses dans les mains des plus riches, phénomène en lien avec la mondialisation, l’affaiblissement des syndicats ou l’augmentation des profits des très grandes entreprises (notamment de la “tech”).
Ajouté à la crise de l’emploi, ce processus alimente une perte de confiance dans les élites, et des théories du complot– phénomène majeur dans les deux élections de Trump (on pense notamment à la théorie QAnon). C’est un ouvrage majeur pour saisir les transformations des États-Unis depuis les années 1990, et notamment le vote Trump.